
|
|
|
 A la campagne, sous l’Ancien Régime, la maison d’habitation, c’est pour la plupart des habitants de la Hesbaye et de la vallée mosane, une masure construite en torchis sur une armature en pan de bois. Seuls, quelques corps de logis des fermes en quadrilatère tranchent avec cet habitat précaire. Il faut d’ailleurs attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir les façades de ces beaux logis donner sur la voie publique. Ces habitations de l’élite adoptent bien souvent les modèles urbains qu’on retrouve dans les villes proches : Huy, Liège ou Namur. A la campagne, sous l’Ancien Régime, la maison d’habitation, c’est pour la plupart des habitants de la Hesbaye et de la vallée mosane, une masure construite en torchis sur une armature en pan de bois. Seuls, quelques corps de logis des fermes en quadrilatère tranchent avec cet habitat précaire. Il faut d’ailleurs attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir les façades de ces beaux logis donner sur la voie publique. Ces habitations de l’élite adoptent bien souvent les modèles urbains qu’on retrouve dans les villes proches : Huy, Liège ou Namur.
Au village, il y a peu ou pas de bâtiments publics. Le curé sert bien souvent d’officier d’état civil et c’est le presbytère, parfois bien construit comme à Warnant, à Haneffe ou à Ampsin, qui sert de maison communale.
La communauté se réunit souvent à l’église ou à l’extérieur. La place publique est souvent un espace ou on discute après les offices, ou on fête les évènements qui marquent la vie religieuse et la vie des champs et ou on parle des affaires communes aux villageois. Mais, c’est aussi là qu’on trouve les espaces communaux et que l’on y mène paître le troupeau. Rien de commun donc avec nos places de village mais plutôt des espaces herbeux avec un flot, véritable mare centrale - actuellement comblé - où grouillait une faune hétéroclite issues des petites exploitations des environs. Porcs, canards, oies et animaux de basse-cour s’y baignaient dans une eau bien souvent nauséabonde.
Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour voir dans les campagnes s’intensifier l’emploi de la brique dans les habitations populaires et amener ainsi un début de confort. Certains colombages emploient alors la brique au lieu de torchis.
Beaucoup de maisons héritent alors d’un étage. Conjuguée avec la Révolution industrielle, la démographie explose et beaucoup de communes doublent leur population. On construit le long des routes. On bouche les espaces entre les anciennes maisons.
Certaines propriétés sont divisées et réparties en plusieurs ménages pour faire face à la demande croissante de nouveaux arrivants. Dans certains villages, des hameaux font leur jonction avec d’autres. 
Le hameau d’Halbosart à Villers-le-Bouillet, par exemple, accueille une population ouvrière qu’il faut loger. La plupart sont des nouveaux arrivants qui travaillent dans les différents charbonnages et qui construisent eux-mêmes leur petite maison, ajoutant ça et là une annexe au gré de leurs moyens.
A côté des industries rurales habituelles comme les moulins, les brasseries et les siroperies, l’introduction de la betterave dans les terroirs hesbignons permet la construction de sucreries comme à Les Waleffes ou Donceel et des râperies comme à Viemme, Chapon-Seraing et Warnant. Ces entreprises demandent aussi une main d’œuvre plus importante.
La population n’arrêtera pas d’augmenter jusqu’aux environs de 1890 date à la quelle la grande crise céréalières obligera une partie des villageois à émigrer vers le bassin liégeois. Un des effets de cette augmentation de la population sera la reconstruction de beaucoup d’édifices religieux dans les styles néo-gothique ou néo-roman. Ampsin, Fize, Vaux-Borset, Vieux-Waleffe, Chapon-Seraing, Bodegnée abattent leurs anciens édifices pour faire place à un autre. D’autres villages l’agrandissent et le transforme en grande partie comme Haneffe et Warnant.
Même si l’industrialisation n’est pas aussi importante qu’aux environs de Liège, les villages mosans changent de physionomie. Ampsin, jadis voué à l’agriculture et à la vigne connaît un important développement industriel grâce aux houillères d’alun et aux fours à chaux. Cela lui confère une physionomie de petite banlieue. Ses « capitaines d’industrie » auront d’ailleurs une grande influence dans le développement urbanistique de la cité à proximité de la petite place. Villas, église, maisons, brasserie, ancienne maison communale et école se côtoient avec la même unité de style et de matériau dans cet espace.
A Amay, avant la révolution liégeoise puis française, seules les maisons des élites, chanoines ou avoués, tranchent et dominent le bourg de leur masse. Certaines d’entre elles sont construites avec goût et dans le plus pur style mosan. Les maisons claustrales, d’une ampleur moyenne, possèdent généralement deux pièces d’apparat au rez-de-chaussée et deux chambres à l’étage. Elles ont un portail, parfois monumental, donnant sur la cour. Dotées de jardins elles possédaient aussi souvent des terrasses supérieures pour la vigne.
A côté de la tour bâtie par leurs ancêtres, les avoués d’Amay firent construire une maison forte dès le XVIe siècle. Les pièces ne se déclinent plus en hauteur mais en longueur. Cette même famille fut à l’origine, vers 1433, d’un hôpital dans la ville pour y "hebergier et ahecier les poevres gens".
Au XIXe siècle, les maisons du centre d’Amay s’opposent à celles des ouvriers saisonniers et des briquetiers. L’augmentation de la population pose d’ailleurs des problèmes de salubrité publique d’autant plus que la voirie faisait l’objet de dépôts de boues, de fumiers ou d’immondices. Les équipements collectifs de distribution et d’évacuation d’eau restèrent insuffisants et l’eau contaminée resta longtemps le premier agent propagateur du choléra.
Dans les villages à côté des grosses fermes cohabitent des maisons plus cossues qui abritent les ruraux qui ont réussi. Certaines adoptent toujours un style traditionnel avec l’emploi du calcaire dans les baies et les chaînages d’angle. D’autres s’essayent dans des styles dits historicistes comme le néo-classique, le néo-roman ou le néo-classicisme.
Ces styles sont d’ailleurs aussi adoptés dans les constructions civiles. Avec le régime français, une modernisation de l’administration va s’opérer et les anciennes seigneuries et communautés d’habitants vont être remplacés par des mairies puis des maisons communales accueillant un bourgmestre et des échevins. L’instruction va aussi prendre son élan, l’école est enfin organisée et on construit aussi des bâtiments adéquats.
Le village accueille aussi une nouvelle bourgeoisie issue de professions libérales. Plusieurs villas vont s’implanter un peu partout. Beaucoup adoptent un style bien particulier : l’Eclectisme. Il s’agit d’un mélange d’éléments appartenant aussi bien à la tradition médiévale qu’à la période baroque ou classique. Le but de cette architecture est de se démarquer du commun. C’est une façon de bâtir ostentatoire. On veut montrer qu’on a réussi. Dans toutes les communes on retrouve ces villas qui furent occupées par un notaire, un médecin ou un industriel.
Les bâtiments de la maison communale d’Amay, achetées à des particuliers, sont particulièrement signifiants puisqu’une des deux villas à appartenu à la Vieille Montagne qui y logeait le directeur et l’autre à un patron briquetier. D’autres courants influenceront aussi ces maisons bourgeoises comme l’art nouveau ou l’art déco mais resteront assez rares.
 On épinglera cependant les quatres magnifiques maisons, chaussée Roosevelt, 34 à 40, à Amay. Elles furent dessinées en 1914 par Maréchal mais furent réalisées après la mort de l’architecte lors de la première guerre mondiale. Il avait eu recours à des motifs végétaux selon l’optique art nouveau. On remarque en effet des carreaux de faïence aux motifs de fleurs dans le tympan des fenêtres ou sur les noms de fleurs - marguerites, roses, lys et glycines - désignant la villa. Les différents niveaux sont aussi soulignés par des bandeaux de briques émaillées et colorées. Les balcons, les verres colorés ainsi que le découpage des toits concourent aussi à donner rythme et légèreté à la façade. On épinglera cependant les quatres magnifiques maisons, chaussée Roosevelt, 34 à 40, à Amay. Elles furent dessinées en 1914 par Maréchal mais furent réalisées après la mort de l’architecte lors de la première guerre mondiale. Il avait eu recours à des motifs végétaux selon l’optique art nouveau. On remarque en effet des carreaux de faïence aux motifs de fleurs dans le tympan des fenêtres ou sur les noms de fleurs - marguerites, roses, lys et glycines - désignant la villa. Les différents niveaux sont aussi soulignés par des bandeaux de briques émaillées et colorées. Les balcons, les verres colorés ainsi que le découpage des toits concourent aussi à donner rythme et légèreté à la façade.
L’extension de l’habitat bourgeois ne doit pas faire oublier l’énorme population ouvrière. La révolution industrielle appellera des transformations sociales à l’origine de la montée en flèche du parti ouvrier puis du parti socialiste. Cela donnera lieu à des infrastructures importantes comme les coopératives ou les maisons du peuple. Ces dernières, malheureusement tombée un peu en désuétude, ont de véritables projets d’éducation ouvrière. Celle de Villers-le-Bouillet, par exemple, dont la salle des fêtes est reprise dans un inventaire européen, projetait bibliothèques, salles de réunion et de cinéma.
Les routes et les moyens de communication permirent les transports modernes. Les chemins de fer offrirent à la vallée les premières gares. Mais les villages ne furent pas en reste puisqu’un réseau de vicinaux avec ses infrastructures quadrilla la région. Des chaussée relièrent les villes entre elles et permirent à certains villages de sortir de leur isolement. Toutes ces modifications ont laissé bien des traces dans le paysage de la région.
 A certains moments on parlait de plus en plus souvent de rurbanisation. La région Hesbaye Meuse se trouve sur la « dorsale wallonne » avec l’autoroute de Wallonie qui la traverse. Cela lui apporte un développement économique certain car de plus en plus d’industries choisissent des zonings à proximité des voies rapides. Mais ces industries dévorent de l’espace et il est heureux qu’on ait réagi en imposant des zones d’habitat, de culture ou de développement industriel. Actuellement les plans de secteur sont revus en intégrant des zones paysagères à conserver. La sensibilisation au patrimoine fait aussi partie de la politique de la région wallonne qui dressera son prochain inventaire en insistant sur les ensembles architecturaux et leur environnement plutôt que sur un bâtiment en particulier. A certains moments on parlait de plus en plus souvent de rurbanisation. La région Hesbaye Meuse se trouve sur la « dorsale wallonne » avec l’autoroute de Wallonie qui la traverse. Cela lui apporte un développement économique certain car de plus en plus d’industries choisissent des zonings à proximité des voies rapides. Mais ces industries dévorent de l’espace et il est heureux qu’on ait réagi en imposant des zones d’habitat, de culture ou de développement industriel. Actuellement les plans de secteur sont revus en intégrant des zones paysagères à conserver. La sensibilisation au patrimoine fait aussi partie de la politique de la région wallonne qui dressera son prochain inventaire en insistant sur les ensembles architecturaux et leur environnement plutôt que sur un bâtiment en particulier.
Des efforts sont cependant encore à faire pour éviter une certaine banalisation de l’habitat. Il semble que dans la région on soit obligé de choisir entre un urbanisme sauvage et une politique d’aménagement du territoire qui respecte l’identité des villages.
|
|
|



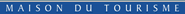
 A la campagne, sous l’Ancien Régime, la maison d’habitation, c’est pour la plupart des habitants de la Hesbaye et de la vallée mosane, une masure construite en torchis sur une armature en pan de bois. Seuls, quelques corps de logis des fermes en quadrilatère tranchent avec cet habitat précaire. Il faut d’ailleurs attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir les façades de ces beaux logis donner sur la voie publique. Ces habitations de l’élite adoptent bien souvent les modèles urbains qu’on retrouve dans les villes proches : Huy, Liège ou Namur.
A la campagne, sous l’Ancien Régime, la maison d’habitation, c’est pour la plupart des habitants de la Hesbaye et de la vallée mosane, une masure construite en torchis sur une armature en pan de bois. Seuls, quelques corps de logis des fermes en quadrilatère tranchent avec cet habitat précaire. Il faut d’ailleurs attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir les façades de ces beaux logis donner sur la voie publique. Ces habitations de l’élite adoptent bien souvent les modèles urbains qu’on retrouve dans les villes proches : Huy, Liège ou Namur.



 On épinglera cependant les quatres magnifiques maisons, chaussée Roosevelt, 34 à 40, à Amay. Elles furent dessinées en 1914 par Maréchal mais furent réalisées après la mort de l’architecte lors de la première guerre mondiale. Il avait eu recours à des motifs végétaux selon l’optique art nouveau. On remarque en effet des carreaux de faïence aux motifs de fleurs dans le tympan des fenêtres ou sur les noms de fleurs - marguerites, roses, lys et glycines - désignant la villa. Les différents niveaux sont aussi soulignés par des bandeaux de briques émaillées et colorées. Les balcons, les verres colorés ainsi que le découpage des toits concourent aussi à donner rythme et légèreté à la façade.
On épinglera cependant les quatres magnifiques maisons, chaussée Roosevelt, 34 à 40, à Amay. Elles furent dessinées en 1914 par Maréchal mais furent réalisées après la mort de l’architecte lors de la première guerre mondiale. Il avait eu recours à des motifs végétaux selon l’optique art nouveau. On remarque en effet des carreaux de faïence aux motifs de fleurs dans le tympan des fenêtres ou sur les noms de fleurs - marguerites, roses, lys et glycines - désignant la villa. Les différents niveaux sont aussi soulignés par des bandeaux de briques émaillées et colorées. Les balcons, les verres colorés ainsi que le découpage des toits concourent aussi à donner rythme et légèreté à la façade. A certains moments on parlait de plus en plus souvent de rurbanisation. La région Hesbaye Meuse se trouve sur la « dorsale wallonne » avec l’autoroute de Wallonie qui la traverse. Cela lui apporte un développement économique certain car de plus en plus d’industries choisissent des zonings à proximité des voies rapides. Mais ces industries dévorent de l’espace et il est heureux qu’on ait réagi en imposant des zones d’habitat, de culture ou de développement industriel. Actuellement les plans de secteur sont revus en intégrant des zones paysagères à conserver. La sensibilisation au patrimoine fait aussi partie de la politique de la région wallonne qui dressera son prochain inventaire en insistant sur les ensembles architecturaux et leur environnement plutôt que sur un bâtiment en particulier.
A certains moments on parlait de plus en plus souvent de rurbanisation. La région Hesbaye Meuse se trouve sur la « dorsale wallonne » avec l’autoroute de Wallonie qui la traverse. Cela lui apporte un développement économique certain car de plus en plus d’industries choisissent des zonings à proximité des voies rapides. Mais ces industries dévorent de l’espace et il est heureux qu’on ait réagi en imposant des zones d’habitat, de culture ou de développement industriel. Actuellement les plans de secteur sont revus en intégrant des zones paysagères à conserver. La sensibilisation au patrimoine fait aussi partie de la politique de la région wallonne qui dressera son prochain inventaire en insistant sur les ensembles architecturaux et leur environnement plutôt que sur un bâtiment en particulier.