Kilométrage : ± 8 km
Départ : Parking face à l'église Saint-Martin (chaussée Freddy Terwagne - Hermalle-sous-Huy).
Balisage : Rectangle vert
Région géographique : Vallée mosane - Ardenne Condrusienne
Difficulté : Sentiers forestiers
 1. Village de Hermalle-sous-Huy
1. Village de Hermalle-sous-Huy
Le centre du
village de Hermalle-sous-Huy est un ensemble architectural du plus haut intérêt avec ses fermes groupées autour du château et de l’église. Il est également un centre touristique avec la ferme castrale (du château) qui accueille deux musées : ceux de la poste et de la gourmandise. Le reste du village présente plutôt un habitat dispersé avec ses fermes isolées et ses hameaux éparpillés dans la forêt, et caractéristique de la région de l’Ardenne condrusienne.
L’architecture du village remonte principalement aux XVII
e et XVIII
e siècle. Le château médiéval à l’origine fut reconstruit au XVII
e siècle. Dans l’avant cour, une annexe d’écuries et de remises a été construite au XIX
e siècle. Sa ferme castrale est un ensemble à plan carré des XVII
e et XVIII
e siècle. L’église dédiée au patron de la Gaule, saint Martin a été reconstruite en 1597 et au milieu du XVII
e siècle. Le cimetière ombragé accueille la dalle funéraire d’un des chanoines de Flône, G.Wailley. La paroisse était en effet desservie par l’abbaye de Flône située de l’autre côté du fleuve. Contre le mur de clôture a été érigé la chapelle funéraire en style néo-gothique des « de Potesta », dernière

famille noble à posséder le château.
Le reste du cœur historique s’est dessiné également à la fin de l’Ancien Régime avec la ferme aux deux tours dite « Cense casal » (1610), la ferme d’Ans (1630), la ferme castrale dite « Maison de la Boverie » (1642), la maison vicariale (1676) et le Relais de poste.
On épinglera la jolie maison classée et actuel presbytère construite par le père de Jean Gilles Jacob, architecte entre autres du château de Warfusée et de l’hôtel de ville de Huy.
Pour commencer la promenade, on suivra pendant quelques mètres la grand route depuis le parking jusqu’au tournant. A cet endroit, on traversera prudemment car la visibilité n’est pas très bonne. On prendra la petite route qui monte puis le chemin dans les bois. Dans la forêt, on suivra les flèches de direction.
2. Le milieu forestier
Tout au long de la promenade, nous sillonnons un milieu forestier diversifié où les feuillus voisinent avec des résineux. La forêt de feuillus est constituée principalement de hêtres avec des troncs gris et presque lisses auquel se mêlent les chênes à l’écorce brunâtre et fissurée, quelques bouleaux aux troncs blancs.
Les résineux sont représentés par des pins de Corse, des pins sylvestres, des épicéas et des mélèzes (exception parmi les conifères européens : le seul à perdre toutes ses feuilles en hiver !).
Cette diversité se manifeste également par un sous bois varié : fougère aigle, myrtilles, clématite des haies, houblon, ... Exception faite du sous bois plus acide et plus ombragé présent sous les conifères.
Ces biotopes permettent d’accueillir une faune varié que l’on peut percevoir par différents indices :
- chants des oiseaux (mésange à longue queue, le pic épeiche, ...)

- empreintes (sabot du chevreuil ou du sanglier, pattes du renard)
- pelotes de rejection de la chouette
- restes de repas (présence de cônes et d’écailles jetés sur le sol par l’écureuil et disséminés sur une grande superficie, appelée "la table" ; noisette coincée dans une fente d'arbre, appelée « forge » que l'oiseau, peut être un pic épeiche ou une sitelle, a placé pour qu’il ne glisse pas pendant qu'il perce à coups de bec la coque, ... sans oublier les autres signes de la présence d'un animal tels que les coulées (petit chemin tracé par le passage de l'animal), les laissées et autres crottes (moquettes du chevreuil)...
Après une longue boucle dans la forêt, on redescend vers la vallée de la Meuse en regagnant la route jusqu’au hameau des forges. Auparavant, on peut faire un petit détour vers la tour Malherbe à la limite de la commune de Nandrin.
3. La tour Malherbe
La tour Malherbe est un exemplaire d’une de ces tours de chevaliers qu’on retrouve à suffisance dans le Condroz et en Hesbaye. Jadis entourée de douves, ce petit donjon fut sans doute à l’origine de ce hameau située dans une clairière issue de défrichements. D’origine médiévale, la tour est construite en moellons de grès local. Elle fut l’objet d’aménagement au XVI
e et XVIII
e siècles. Les bâtiments agricoles qui l’accompagnent sont du même matériau mais élevés sous l’Ancien régime.
Après avoir découvert le donjon appelé tour malherbe on fait demi-tour et on rejoint par la grand route un groupe de maisons appelé :
 4. Le hameau des Forges
4. Le hameau des Forges
Comme son nom l’indique ce petit groupement de maison était un petit centre métallurgique. Au XVIII
e siècle avant la diffusion industrielle du charbon, le principal combustible était le bois. Beaucoup de petites forges se trouvaient donc à proximité d’un petit cours d’eau au débit suffisant pour permettre d’actionner moulins, forges et marteaux et à côté de la forêt grande pourvoyeuse du combustible à l’époque.
On quitte la nationale à gauche et dans le hameau, après avoir passé le petit pont, on suit le ruisseau du fond d’Oxhe par un petit chemin qui nous donne un beau point de vue sur la région.
5. La structure géologique de l’Ardenne condrusienne
Cette région assimilée parfois au Condroz présente pourtant des similitudes géographiques proches des Ardennes sur une bande de 5 à 6 km qui suit la rive droite de la Meuse puis celle de la Sambre (Marlagne). Sa diversité se manifeste aussi par une géologie complexe. Nous nous trouvons dans une zone transitoire entre la vallée de la Meuse et le début du Condroz. Il y a 300 millions d’années, le Condroz et l’Ardenne ont glissé vers le Nord le long de la faille Eifelienne. Ainsi, au niveau de la nature des roches, on peut résumer en disant que le sous-sol situé au nord de cette faille est constitué principalement de Schistes noirs très plissés (bien visibles le long de la voie rapide), au sud, on trouve des roches plus anciennes comme le Grès.
On continue le chemin et on rejoint la route de Liège à Ombret. On suit la route à droite puis on tourne à gauche et on gravit le chemin qui nous mène au Thier d’Olne où on observe des cailloux roulés non cimentés vestiges de terrasses de la Meuse. Le caractère isolé du Thier d’Olne indique que cette colline était à une époque reculée contournée par la Meuse avant qu’elle ne gagne son lit actuel.
6. Le village d’Ombret était autrefois un village forestier. Sous l’Ancien régime, Ombret était composée de quelques maisons de bûcherons, de forestiers, scieurs de long, charrons ou menuisiers qui précédèrent au XVIII
e siècle la création d’une chapelle. Tout le monde vivait plus ou moins du bois. Le village accueillit également des moulins industriels. Au XIX
e siècle sur les bords de la Meuse, un chantier naval vint s’installer en bord du fleuve. Il fabriqua notamment les fameux bateaux « touriste » qui reliaient les localités de la haute Meuse à Namur.
7. Le Thier d’Olne comme on a coutume de le nommer, domine la Meuse et l’endroit où on a découvert l’ancien vicus d’Ombret. Des campagnes de fouilles menées depuis 1985 par le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, sous l’égide de la Région wallonne, ont permis de mettre au jour les vestiges d’un important complexe domanial du Haut Moyen Âge. Construit sur le rebord ouest du plateau surplombant le fleuve, cet ensemble occupe une surface d’environ 3.500 m². Il était composé de structures d’habitats, de plusieurs édifices religieux et d’un cimetière. Trois périodes principales de construction peuvent être restituées. Elles témoignent d’un développement progressif s’étalant du VII
e au X
e siècle. Le centre mérovingien s’est développé jusqu’à l’époque carolingienne et, au IX
e s., le complexe seigneurial comprenait une église et un vaste édifice correspondant à la demeure du maître. Abandonné aux environs de l’an 1000 au profit d’un autre site en hauteur, le rocher d’Engihoul à Clermont, le Thier d’Olne a livré trois malaxeurs à mortier médiévaux.
C’est pratiquement le seul site d’habitat du Haut Moyen Âge en Wallonie à avoir été fouillé de manière aussi exhaustive.
On redescend la butte vers Hermalle et la vallée de la Meuse. Près du fleuve, on découvre la ferme de Hottine, une des premières exploitations de l’abbaye de Flône qu’on peut admirer de l’autre côté du fleuve.
8. La ferme de Hottine

Dès les premières années (1102) de son existence, l’
abbaye de Flône chercha à acquérir des terres dans son voisinage et notamment de ce côté du fleuve. Elle y installa une grange exploitée part des convers et c’est très tôt que Hottine devint une des principales exploitations de l’abbaye. Des bâtiments médiévaux il ne reste évidemment rien. La ferme telle que nous la voyons aujourd’hui a été entièrement reconstruite en 1715. Elle est précédée d’une drève de jeunes hêtres. C’est surtout son portail monumental flanqué de deux ailerons à volutes qui est impressionnant. Pour le reste la ferme abrite granges, écuries, étables comme beaucoup de fermes de la région
On suivra le long chemin de terre qui suit la vallée de la Meuse vers notre point de départ, Hermalle. On remarquera l’ancienne abbaye de Flône qui marqua la vie de Hermalle religieusement et économiquement. Cette dernière nommait le curé de la paroisse de Hermalle et les terres que nous traversons sont à rattacher à la ferme de Hottine qu’on vient de décrire.
C’est aussi dans cette campagne de la Gérée qu’on a découvert deux fours de tuiliers romains. Les tuiles qu’on y cuisait étaient marquées du sigle QVA. Ce type de tuiles servait à recouvrir les toitures des villas.




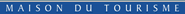
 1. Village de Hermalle-sous-Huy
1. Village de Hermalle-sous-Huy famille noble à posséder le château.
famille noble à posséder le château.
 4. Le hameau des Forges
4. Le hameau des Forges
 Dès les premières années (1102) de son existence, l’
Dès les premières années (1102) de son existence, l’