Kilométrage : 7km500
Départ : Ancienne abbaye de la Paix-Dieu (rue Paix-Dieu)
Balisage : losange rouge
Région géographique : Rebord mosan - Vallée du ruisseau de Bende
Difficulté : Chemins agricoles, sentiers forestiers
1. L’abbaye de la Paix Dieu

L’
abbaye de la Paix-Dieu fut fondée entre 1239 et 1241 par Arnould de Corswaren, chevalier hesbignon, proche du comte de Looz. L’observance cistercienne commandait aux moniales de se constituer un domaine foncier dont la production agricole assurerait la subsistance de la communauté. Grâce à des donations et à une politique intelligente d’achat, les moniales acquirent des biens ruraux, principalement dans la fertile Hesbaye. L’évolution vers un capitalisme foncier, loin du projet monastique initial, permettra aux moniales d’investir dans des nouveaux bâtiments aux XVII
e et XVIII
e siècles. L’église, les bâtiments abbatiaux, l’infirmerie, la ferme et son portail monumental, le colombier et le moulin sont autant de traces de ce passé. L’ensemble monastique accueille aujourd’hui l’Institut du Patrimoine wallon, le Centre des métiers du patrimoine ainsi que le comptoir d’accueil de la Maison du Tourisme Hesbaye et Meuse.
Se diriger en sortant de l’abbaye vers la route de Jehay. Traverser la route et monter le petit sentier à côté d’une maison blanche dans le bois. A la sortie du bois, on traverse une petite campagne.
2. Le paysage de la vallée
Le paysage traversé est fort différent de celui du plateau de la Hesbaye. Le relief est plus prononcé. Il est dû à la petite vallée formée par plusieurs ruisseaux qui se rejoignent à la Paix-Dieu pour former le ruisseau de Bende. Ce dernier se jette quelques kilomètres plus loin dans la Meuse.
A côté des campagnes, on rencontre beaucoup de bois. Les moines de l’abbaye d’Aulne possédaient d’ailleurs une « sylva » à Jehay. Autrefois, la forêt était une réserve de bois pour la construction des maisons et des édifices ainsi que pour l’industrie, notamment pour la fabrication du charbon de bois. Mais, c’était également un lieu où on menait les troupeaux des abbayes et des villageois pour trouver de la nourriture. Les prés étaient en effet fort rares et réservés à la fauche.
Plusieurs forêts ont été défrichées au Moyen Âge mais aussi au XIX
e siècle. Les deux fermes de Saint Lambert qu’on voit sur notre droite en se dirigeant vers les hauteurs de Jehay, ont gagné leur terroir au détriment de la forêt pendant la révolution agricole du XIX
e siècle. Elles adoptent toutes les deux un plan en quadrilatère comme les fermes traditionnelles de Hesbaye.
Après avoir traversé la route d’Amay. Prendre tout droit la rue du Tambour. Avant les maisons, on prend en montant le petit sentier à droite qui sépare les habitations du nouveau lotissement. On continue dans la rue tout droit puis on prend la deuxième rue à gauche et on rejoint la chaussée de Tongres qui relie Jehay à Amay au hameau de Saule Gaillard.
3. Le hameau de Saule Gaillard
Autrefois cette route était une drève bordée d’arbres. Le lieu au XVIII
e siècle se nommait « rue du dessus » et la drève s’arrêtait là où nous avons rejoint la chaussée qui n’existait pas encore à cette époque. Par contre, le chemin qu’on vient d’emprunter est bien présent sur la carte de Ferraris et reliait le dessus du village à l’abbaye de la Paix-Dieu à travers une ancienne forêt.
Ce hameau était sans doute issu d’un défrichement médiéval. Le nom saule Gaillard vient de la prononciation wallonne du mot « sart ». Le hameau est donc issu d’un essartage. Si on observe le parcellaire de la commune en le confrontant à la carte de Ferraris, on remarque une série de propriétés de superficies plus ou moins égales accompagnées d’un jardin et d’un verger comme s’il s’agissait d’un lotissement planifié par un seigneur ou par les habitants eux-mêmes. Cet habitat se différencie par un plan qui semble préétabli par rapport aux autres regroupements de maisons installés en désordre près des sources du village. Il s’agit sans doute d’un écart (habitat intercalaire) situé à la lisière du grand bois de Jehay.
Laissons la première rue à gauche mais empruntons le sentier « el commune » qui descend à travers champs vers le village.
4. Les communes
Avant le Régime français, l’organe du village était la communauté. Celle-ci était censée représenter les villageois et gérer les biens communaux. Ceux-ci étaient souvent composés d’une série de biens ruraux ou de terres qui étaient exploités par tous les villageois. Ces terres étaient souvent d’un revenu médiocre car les plus fertiles appartenaient aux plus riches. Souvent elles avaient l’aspect d’un terrain vague et étaient parfois utilisées pour faire paître le troupeau commun par le herdier du village. Elles faisaient aussi l’objet de plantations et d’exploitation d’arbres. Leurs revenus étaient gérés par la communauté. Le lieu-dit « les communes » rappelle que ces terrains servaient autrefois de communaux aux villageois de Jehay.
5. Le village de Jehay
Le
village de Jehay était installé sur les flancs de vallée du ruisseau Del Venne. Le village se cantonnait principalement un peu au-dessus du ruisseau le long d’une voirie qui le reliait au château. D’autres maisons sont regroupées autour des nombreuses sources du village. Sur les deux coteaux de la vallée, les chemins descendent en suivant une pente. Jehay relevait de la cour féodale de Liège. La seigneurie appartenait aux propriétaires du château. Elle fut acquise par la Province de Liège à la mort du dernier comte van den Steen. En 1736, Jehay comptait 340 habitants.

La plupart des familles villageoises cultivaient un jardin et un lopin de terre dont elles étaient parfois propriétaires mais qu’elles louaient aussi parfois à un des gros fermiers du village ou au châtelain. Cette population rurale était pauvre et subvenait péniblement à ses besoins élémentaires.
Au XIX
e siècle et pendant aussi une grande partie du XX
e siècle de nombreux Jehaytois allaient travailler dans les industries de la vallée de la Meuse. Le village a gardé sa physionomie caractéristique avec des petites maisons alignées et entourées de prairies plantées d’arbres fruitiers et de peupliers.
A la fin du sentier des communes, on prend à gauche puis directement à droite, rue Loumaye. Quelques mètres plus loin à droite après une maison moderne, on prend le petit sentier qui se faufile à travers vergers et jardins.
Arrivé à la route, on la prend à gauche en la descendant vers l’ancien pont du vicinal. On peut faire un détour en prenant vers la droite pour voir la source de Saint-Gérard et la pseudo-maison natale de Zénobe Gramme.
6. La source de Saint Gérard
Anciennement la Fontinne Bènèt (Arthur Bovy). Les habitants du quartier se sont approvisionnés à cette fontaine jusqu’à l’installation de la distribution d’eau, vers les années 50. Le culte de saint Gérard est originaire de la Paix-Dieu et sous l’Ancien Régime c’est dans l’abbaye que les habitants de Jehay et des environs se rendaient en pèlerinage. Après la désertion de l’abbaye par les moniales, le culte se transposa dans le village même où il fait encore l’objet d’un pèlerinage annuel lors de la fête locale à la pentecôte.
7. La pseudo-maison natale de Zénobe Gramme
En réalité, la maison natale de Zénobe Gramme se situe sur la drève Saule Gaillard. Lors de l’inauguration de la plaque commémorative de sa naissance, rue Zénobe Gramme, en 1907, la sœur de celui-ci a dénoncé cette erreur. Inventeur de la dynamo industrielle, Zénobe Gramme est né à Jehay le 4 avril 1826, il est décédé à Bois-Colombe (France) le 20 janvier 1901 ; il est inhumé au Père Lachaise.
On rebrousse chemin et on descend la rue Zénobe Gramme.
 8. L’ancien pont du vicinal
8. L’ancien pont du vicinal
Ce pont a été construit vers 1912 et a été utilisé seulement en 1923, lors de la mise en circulation de la ligne Ampsin-Verlaine. Les trams vicinaux ont emprunté cette ligne jusqu’au début de la guerre 40-45. Il a fait l’objet d’une restauration.
On prend la route du fonds de vallée à droite vers le château en suivant ce fonds humide ou se trouvaient anciennement les prés de fauche et parsemé de sources. Prendre la première à droite, rue Ernou puis à gauche.
9. La ferme Marchandise
En retrait et séparée de la rue par un jardin clos d’un mur percé d’un portail à linteau chantourné, l’habitation en double corps fut aménagée en deux temps au XVIII
e siècle sur un noyau plus ancien subsistant à gauche.
Au Tambour, prendre à droite puis à gauche vers le château de Jehay.
10. Le château de Jehay et ses jardins
L’ensemble du site et du
château de Jehay, avec sa chapelle, son jardin et le village s’est établi dans un environnement de bois, d’étangs et de prairies, à proximité du ruisseau de la Paix-Dieu.
Il comporte aussi deux belles allées bordées de châtaigniers. Actuellement, le château est toujours entouré d’un des plus beaux parcs de la Province de Liège.
Vers 1130, un certain Henri de Jehain est qualifié d’homme libre et fait donc partie de l’ancienne aristocratie du pays de Liège. Il habite une tour dont seules les caves nous parviendront. A l’Epoque Moderne, le château continua d’appartenir à quelques grandes familles liégeoise. Un des membres de la famille de Mérode, Jean, se distingua comme gouverneur de la ville et du château de Huy pendant la guerre de Trente Ans. En 1680, le bien passa à la famille van den Steen qui le conserva jusqu’à son récent rachat par la province de Liège.

Lors de la guerre entre les Hornes et les de la Marck, le château fut détruit en partie. Aux XVI
e et XVII
e siècles, il fut reconstruit et prit l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui. Sa particularité architecturale lui vient de sa façade constituée d’un damier fait avec du grès et des pierres blanches. L’ensemble est entouré de tours et de douves et comporte quatre volumes bien distincts reliés par des cours et des ponts enjambant les douves. Le château en L est en grande partie du début du XVI
e siècle. La partie ouest est de style néo-gothique.
La chapelle castrale, proche du porche d’accès du château et bordée d’un petit cimetière entouré d’eau, est devenue l’église paroissiale de Jehay. S’ouvrant vers la communauté villageoise, elle fut dédiée à saint Lambert. Sa nef du XVI
e siècle en moellons de grès a été restaurée vers 1635 et flanquée d’une tour carrée, coiffée d’un petit pavillon d’ardoise.
Devant l’entrée principale du château on prend l’ancienne drève qui se dirige vers Rogerée et le « Vieux tribunal ». On observe sur le côté les étangs alimentés par le ruisseau de la Paix-Dieu. Passé cette partie boisée, on prend à gauche le chemin en terre le long du bois puis on continue quelques mètres le chemin en asphalte. On prend ensuite le petit chemin en contrebas du n°8 et après avoir pris un court moment la petite ruelle asphaltée, on prend le sentier à droite et le chemin creux : ancien site du tram.
11. Le tilleul
La rue Tilleul del Motte doit son nom aux deux tilleuls qui en caractérisaient son tracé vers la Hesbaye, visibles sur la carte de 1850. Les tilleuls possèdent des vertus calmantes, diurétiques, sudorifiques et cholérétiques. Mais des propriétés médicinales aux dons surnaturels, il n’y a qu’un pas à faire, et c’est ainsi que le tilleul s’est retrouvé à la première place des arbres à clous. Le secours de l’arbre et du tilleul, en particulier, était surtout invoqué pour les affections cutanées et les maux de dents. Deux espèces de tilleul et leur hybride naturel poussent spontanément dans certaines de nos forêts et tiennent le haut du pavé dans nos villages ; le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) et le tilleul hybride ou de Hollande (Tilia x europaea).
 On traverse la rue et on reprend la voie du tram pour quelques temps. On passe sur le pont du tram. Sur ce trajet, on peut admirer le paysage du fonds de Jehay et on rencontre quelques éléments importants du petit patrimoine et de la mémoire collective villageoise.
On traverse la rue et on reprend la voie du tram pour quelques temps. On passe sur le pont du tram. Sur ce trajet, on peut admirer le paysage du fonds de Jehay et on rencontre quelques éléments importants du petit patrimoine et de la mémoire collective villageoise.
12. Hacquenière
La promenade emprunte une partie du tracé de l’ancien vicinal, notamment un pont en brique réalisé par la Société des Chemins de fer Vicinaux.
13. Les anciennes houillères
L’exploitation du charbon dans la région remonte sans doute au Moyen Âge. Une veine importante allant de Jehay en passant par la Paix-Dieu, Halbosart, le sartage à Ampsin, la campagne de Villers-le-Bouillet, la Marexhe et Antheit fut l’objet de plusieurs concessions à des institutions religieuses, comme la Paix-Dieu, Le Neufmoutier, l’abbaye de Flône et le chapitre Saint Barthélemy, ou à quelques particuliers. Au XIX
e siècle quelques charbonnages entreprirent le creusement en profondeur de galeries nécessitant notamment des machines pour l’extraction et l’évacuation des eaux.
On rejoint ensuite la rue Nihotte qui descend vers la route du fonds de vallée.
14. ND de Bonsecours
Cette chapelle a été érigée vers 1910 en remerciement à Notre Dame du Bon Secours. L’enfant d’une famille a été guéri d’un handicap aux jambes. On peut voir dans la chapelle deux petites jambes découpées dans du carton et accrochées au mur.
15. Les ruisseaux et le fonds humide de la Paix Dieu
Sur la carte de Ferraris (1780), on peut voir que le fond de la vallée était marécageux. La rue petit Rivage a été construite vers les années 1910, pour relier la route d’Ampsin et Huy au village de Jehay. Le ruisseau Dèl Vène a été canalisé en 1980. Ce dernier ruisseau prend sa source ‘A tchan d’Ouhê’ (au chant des oiseaux) non loin de la ferme de Malgueule ; il alimente enfin li Bî dè Molin (le bief du moulin) de la Paix-Dieu. Un deuxième a son origine en bas de la ruelle Loumaye (Jehay) et porte le nom poétique ‘dè rèwe dè pré al cawe’ (ruisseau du pré à la queue), il s’engouffre sous le chemin qui va è Rôtchamp, au lieu, où jadis se faisait l’arrêt du tram. Il s’adjoint ‘li rèwe di Tchâlet’ (le ruisseau de Tchâlet) qui avait déjà accompli sa jonction avec celui Dèl Vène et traverse, ainsi grossi, la prairie de la Paix-Dieu et devient enfin le ruisseau de Bende allant terminer sa course dans la Meuse.
On rejoint la Paix-Dieu en prenant la route de la vallée vers la droite.




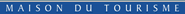
 L’
L’
 8. L’ancien pont du vicinal
8. L’ancien pont du vicinal


