
|
Traversé par le Geer, structuré de part et d’autre d’une rue centrale contournant le château, ancien centre seigneurial, et laissant quelque peu de côté son église et l’enclos paroissial, le village de Hollogne-sur-Geer semble disposer ses maisons de manière lâche dans un environnement naturel. Prairies, vergers, marais servant de « communaux », drèves arborées menant au château, petits espaces boisés, maisons et fermes entourées de leur courtil, sont les éléments principaux de ce paysage villageois, repris ici sur une carte du début de la période française. La campagne et ses grandes parcelles cultivées de céréales sont à peine ici ébauchées au pourtour de ce que les géographes appellent maintenant l’auréole villageoise, parce qu’y figure le bâti entouré de sa couronne de prés et de vergers. Aujourd’hui, le village s’est quelque peu gonflé, aménagé, modernisé. Certains éléments de ce paysage patrimonial ont disparus ou n’ont laissé que quelques vestiges. L’usure du temps y a fait ici des dommages.
Mais, pour le promeneur, Hollogne-sur-Geer est encore un de ces villages où on peut y lire le passé à travers un patrimoine resté exceptionnel mais aussi grâce à un environnement bien conservé et hérité des époques où cette communauté villageoise s’est constituée, au Moyen Âge et à l’Epoque Moderne.
|

Carte de 1801, dressée par G. Leduc, arpenteur géomètre forestier
1. Histoire de la seigneurie de Hollogne-sur-Geer
La seigneurie de Hollogne-sur-Geer fait partie de ces terres disputées par les principautés territoriales au Moyen Âge. Elle fut tour à tour convoitée par les ducs de Brabant, puis par les comtes de Namur, qui donnèrent la seigneurie à un de leurs vassaux, les Atrive, puis par les Prince-évêques de Liège qui finirent par annexer le village à leur territoire.
Au Moyen Âge, c’est devant le comte de Namur, que le seigneur de Hollogne relève sa terre. Un acte de 1229, nous renseigne comment les Atrive acquirent le domaine de Hollogne et devinrent les propriétaires des biens du comte dans cette localité. C’est en échange de la renonciation à l’avouerie d’Andenne, que cette famille de nobles fut la première à détenir la seigneurie de Hollogne.
Ils gardèrent la seigneurie jusqu’en 1311, date à laquelle une branche des Warfusée, proche des Prince-évêques, les Harduemont, entrèrent en possession de la seigneurie et du château en même temps que des seigneuries de Darion, Boëlhe et du Manil.
En 1447, l’héritier Godefroid de Harduemont, mourut sans héritier mâle et sa fille Catherine, épousa Jehan de Seraing. Château et biens passèrent alors aux mains de la famille de Seraing qui les garda jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, pendant près de 5 siècles. Les seigneurs eurent à cette époque une Haute Cour de Justice qui reconnaissait les échevins de Liège comme chef de sens.
 La seigneurie et le village d’Hollogne furent le théâtre de nombreux conflits depuis le Moyen Âge. Déjà, lors de la guerre des Awans et des Waroux, ces derniers attaquèrent le château en 1312 et firent trancher la gorge à trois proches du seigneur, Jean de Harduémont, parce qu’il était proche du parti opposé des Awans. La seigneurie et le village d’Hollogne furent le théâtre de nombreux conflits depuis le Moyen Âge. Déjà, lors de la guerre des Awans et des Waroux, ces derniers attaquèrent le château en 1312 et firent trancher la gorge à trois proches du seigneur, Jean de Harduémont, parce qu’il était proche du parti opposé des Awans.
Pendant l’époque bourguignonne, en 1483, le village fut l’objet d’une bataille, sanglante lors d’une guerre de succession à la tête de la Principauté de Liège, où le célèbre Guillaume de La Marck, le sanglier des Ardennes, avait fait élire son fils, après le meurtre du Prince Louis de Bourbon. Maximilien d’Autriche, voulut venger la mort de son ancien allié et à la tête d’une armée, ravagea plusieurs villes thioises, Saint-Trond, Tongres et Hasselt. Il assiégea le château de Hollogne défendu par une centaine d’hommes, qui capitula après avoir été pilonné par l’artillerie. Lors de cet assaut fut d’ailleurs utilisé une nouvelle arme qui fit bien des ravages, la couleuvrine, sorte de petit canon, long et effilé. En réaction à cet assaut, Guillaume de la Marck mobilisa une armée composée d’habitants des villes et des campagnes de son pays afin de reprendre le château. Mais mal lui en pris, car son armée tomba dans un piège où l’infanterie adverse appuyée par les bourguignons décima l’armée liégeoise pourtant bien supérieure en nombre. Ce fut la victoire de la stratégie et de l’armée moderne de Maximilien contre celle encore archaïque et médiévale des liégeois.
Cette bataille laissa le château en partie en ruines et le parc dévasté. Les habitants du village eurent à subir les réquisitions par les nouveaux occupants. Il faudra attendre 1492, année ou la Principauté retrouva sa neutralité pour que la paix revienne sur le village.
L’époque moderne connut aussi guerres et dévastations. Les armées européennes passaient dans la Principauté de Liège même si celle-ci avait proclamé sa neutralité. En 1651, des soldats lorrains trouvèrent refuge dans le château de Hollogne qui fut assiégé et de nouveau détruit.
En 1672, le village de Hollogne fut traversé par les armées de Turenne qui rasèrent le verger près du château. Le seigneur alla trouver Louis XIV, qui campait à Wasseiges avec une armée de 40.000 hommes, pour lui demander d’épargner sa seigneurie. Mais les désordres et les dommages de guerre ne cessèrent pas malgré des paroles d’apaisement du Roi. Les campagnes furent pillées, les jardins détruits et des arbres fruitiers abattus. En 1673, c’est une armée de 15.000 hommes dirigée par Condé qui campa à Hollogne. Les mêmes pillages et exactions sont à déplorer. Toutes ces rapines se répétèrent à chaque fois que des armées traversèrent les campagnes de Hesbaye et notamment en 1693 , quand le château de Hollogne fut de nouveau pillé par les Français quelques jours après la bataille de Neerwinden. Les guerres avec les épidémies et les disettes n’épargnèrent guère la seigneurie de Hollogne et ses habitants.
Malgré les aléas de la grande histoire, les destructions et les reconstructions, le village de Hollogne-sur-Geer et les vestiges de sa seigneurie restent un des ensembles patrimoniaux parmi les plus intéressant de Hesbaye.
2. L’ensemble seigneurial
Le château de Hollogne-sur-Geer
Le château n’a pas en effet été épargné et c’est sans doute lui qui représente le mieux les stigmates des guerres sans mercis qui se livrèrent sur le sol du village. A la fin du XVIIIe siècle et dans une période relativement paisible, de Saumery dans son livre sur les délices du Pays de Liège, l’avait décrit comme un château fort encore défendu par une solide tour carrée. Il avait également souligné dans l’ensemble la tour, l’enceinte intérieure et la cour carrée d’ « environ cent piés ». Du corps de logis, il avait retenu « un portique relevé en terrasse » et que les « Appartements sont riants et commodes ». Il avait été aussi frappé par l’environnement constitué d’étangs et de haute futaie.
Aujourd’hui, il ne subsiste que 3 éléments de périodes différentes de l’ensemble castral. Du château fort reconstruit au XVIe siècle, il ne reste qu’une muraille en moellons de grès.

La tour ronde est le vestige principal. Elle est datée de 1652. Elle est défendue par deux arquebusières à encadrement calcaire. Le haut soubassement de cet élément architectural rescapé des guerres et d’une longue période d’abandon, accueillait l’ancienne salle de garde du château. Autrefois, le corps de logis, aujourd’hui disparu, était adossé à cette tour. A l’est, un reste de maçonnerie est en effet une trace de cet ancien logis.
Enfin, dans le parc, subsiste une ancienne dépendance de la fin du XVIIIe siècle. Elle est datée précisément de 1779 sur une dalle couronnée aux armes des « de Seraing ». La façade de ce bâtiment est particulièrement intéressante avec ses trois entrées charretières séparées chacune par un pilastre à refend et inscrites dans un encadrement calcaire.
Ferme du château
A chaque résidence seigneuriale, son intendance. Le château de Hollogne était également accompagné d’une traditionnelle ferme hesbignonne dont il reste quelques vestiges, rue de Celles. Son plan était en U et elle avait été reconstruite à la fin du XVIIIe siècle comme l’atteste le millésime 1760, surmontant une des portes du logis. Malheureusement, de nombreux aménagements au XIXe et XXe siècle ont quelque peu altéré cet ensemble en briques et calcaires. Il reste que le logis bas d’un niveau et demi et de quatre travées, présente quelques particularités intéressantes comme deux perrons d’accès aux portes et une frise de briques denticulées. La ferme a également conservé le logis où dormaient les ouvriers saisonniers.
Le Moulin seigneurial
 Situé un peu en retrait de la rue principale, l’ensemble du moulin seigneurial et de ses dépendances a été construit par le seigneur de Hollogne, Godefroid de Seraing, en 1646 sur le cours du Geer. Au Moyen Âge étaient souvent attachés au moulin des droits banaux qui permettaient au seigneur de contraindre les habitants de sa juridiction à venir moudre leur grain contre une redevance. Cette banalité était souvent une source précieuse de revenus pour le seigneur. Au XVIIIe siècle, un meunier était chargé du bon fonctionnement du moulin seigneurial. Le moulin rapportait 6 ½ setiers par semaine (un setier = 156 litres). Situé un peu en retrait de la rue principale, l’ensemble du moulin seigneurial et de ses dépendances a été construit par le seigneur de Hollogne, Godefroid de Seraing, en 1646 sur le cours du Geer. Au Moyen Âge étaient souvent attachés au moulin des droits banaux qui permettaient au seigneur de contraindre les habitants de sa juridiction à venir moudre leur grain contre une redevance. Cette banalité était souvent une source précieuse de revenus pour le seigneur. Au XVIIIe siècle, un meunier était chargé du bon fonctionnement du moulin seigneurial. Le moulin rapportait 6 ½ setiers par semaine (un setier = 156 litres).
Une pièce d’archive jointe au cadastre primitif conservé à Liège, nous livre une précieuse description du moulin et de son fonctionnement : « situé sur le ruisseau du Geer à ½ lieue de sa source, composé de deux couples de meules activées alternativement par un tournant à baquets de 14 à 19 pieds de diamètre, mis en mouvement au moyen d’un réservoir qui retient les eaux jusqu’à ce qu’elles soient suffisantes pour l’activer pendant quelques heures. Le bâtiment est construit en pierres et en briques, couvert d’ardoises, en médiocre état... ».
A la construction du bâtiment, le lit du Geer et celui du faux Geer, dont le confluent se trouve à quelques dizaine de mètres en amont du moulin, furent détournés et aménagés pour permettre la bon alimentation en eau du moulin. Un système de vannes permettait de régler le débit de l’eau. Souvent, ces vannes étaient fermées la nuit pour permettre un fort débit en journée.
Quant au bâtiment du moulin, c’est une architecture de son époque et de sa région. Il consiste en un ensemble en briques et calcaires, cantonné de chaînages d’angle qui, à l’origine, comportait un niveau et trois travées. Mais il fut exhaussé au début du XIXe siècle d’un niveau et demi. Il y eut encore d’autres remaniements au XIXe et XXe siècle jusqu’à sa rénovation au début de ce XXIe siècle.
Le moulin restera en activité jusqu’en 1948.On détournera même les eaux du Geer de l’ensemble pour qu’elles évitent les roues à aubes.
 Aujourd’hui son nouveau propriétaire, l’architecte Pierre Lorenzi, lui a assigné une nouvelle affectation. D’abord, les bâtiments ont été restaurés en 2006 et 2007. Ensuite, c’est tout naturellement vers la production d’électricité verte que la réhabilitation de la roue a été envisagée. Actuellement, la production d’électricité verte n’atteint que 25% de sa capacité. L’objectif est d’atteindre les 4 kW de puissance, ce qui permettra d’économiser près de 4,5 tonnes de CO², soit l’équivalent de 1% de la consommation de ménages moyens de la commune de Geer. La réaffectation du moulin s’oriente aussi vers la location des lieux en centre de séminaires, de festivités diverses ou encore d’ateliers du bien-être, afin qu’un large public puisse en bénéficier. S’exprime ainsi une volonté de diffuser la richesse patrimoniale et architecturale dans un esprit de « réaffectation respectueuse ». Ces fonctions permettent de maintenir les bâtiments dans leurs volumétries premières, sans cloisonnements intérieurs ni percements divers. Quant au corps de logis, il a conservé sa fonction résidentielle pour les propriétaires et leur famille. Un bel exemple d’un bâtiment ancien répondant aux défis d’aujourd’hui ! Aujourd’hui son nouveau propriétaire, l’architecte Pierre Lorenzi, lui a assigné une nouvelle affectation. D’abord, les bâtiments ont été restaurés en 2006 et 2007. Ensuite, c’est tout naturellement vers la production d’électricité verte que la réhabilitation de la roue a été envisagée. Actuellement, la production d’électricité verte n’atteint que 25% de sa capacité. L’objectif est d’atteindre les 4 kW de puissance, ce qui permettra d’économiser près de 4,5 tonnes de CO², soit l’équivalent de 1% de la consommation de ménages moyens de la commune de Geer. La réaffectation du moulin s’oriente aussi vers la location des lieux en centre de séminaires, de festivités diverses ou encore d’ateliers du bien-être, afin qu’un large public puisse en bénéficier. S’exprime ainsi une volonté de diffuser la richesse patrimoniale et architecturale dans un esprit de « réaffectation respectueuse ». Ces fonctions permettent de maintenir les bâtiments dans leurs volumétries premières, sans cloisonnements intérieurs ni percements divers. Quant au corps de logis, il a conservé sa fonction résidentielle pour les propriétaires et leur famille. Un bel exemple d’un bâtiment ancien répondant aux défis d’aujourd’hui !
Brasserie castrale
Ancienne dépendance du château, située à 200m du château, la brasserie a peut être aussi été à l’origine une brasserie banale où les habitants étaient tenus de venir fabriquer leur bière contre redevance. Le bâtiment est orné d’une dalle où figurent des boucliers soutenus par des lions aux armes couronnées de l’alliance de Seraing-Soumagne, avec une devise en latin : « Virtute et patientia/vince 1753 ». La brasserie fut élevée par François Alexandre de Seraing à cette date, mais elle a malheureusement subie des remaniements malheureux à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. On épinglera quand même une très belle façade-pignon en briques autrefois enduite d’un badigeon rouge.
3. L’ensemble ecclésial
L’église
 Située un peu à l’écart du complexe castral, l’église Saint Brice, est un édifice au plan assez complexe. Les matériaux employés, brique, calcaire et grés régional, sont assez divers et révèlent un édifice construit sur plusieurs époques au gré de la fréquentation des paroissiens. Elle fut remaniée plusieurs fois et le bâtiment est composé d’une nef médiévale, de bas côtés, d’un transept et d’un chœur. Un portail latéral, daté de 1526 et placé au nord ouest de l’édifice, est englobé dans un porche du XVIIIe siècle. Une sacristie fut également ajoutée à cette époque. Située un peu à l’écart du complexe castral, l’église Saint Brice, est un édifice au plan assez complexe. Les matériaux employés, brique, calcaire et grés régional, sont assez divers et révèlent un édifice construit sur plusieurs époques au gré de la fréquentation des paroissiens. Elle fut remaniée plusieurs fois et le bâtiment est composé d’une nef médiévale, de bas côtés, d’un transept et d’un chœur. Un portail latéral, daté de 1526 et placé au nord ouest de l’édifice, est englobé dans un porche du XVIIIe siècle. Une sacristie fut également ajoutée à cette époque.
L’église comporte tout d’abord une nef de trois travées rythmée par d’épais piliers carrés à imposte supportant des arcs brisés dont le gros œuvre remonte sans doute au XIIIe siècle. Cette nef s’ouvrait sans doute au Moyen Âge vers l’extérieur, côté village, directement au niveau de la première travée nord. C’est en effet, dans un pilier situé à cet endroit de la nef qu’on trouve une intéressante niche-bénitier gothique de forme trilobée.
Les bas côtés ne furent élevés qu’aux XVIe et XVIIe siècle en briques et calcaires sur un petit soubassement en grand appareil calcaire. Le chœur au chevet à trois pans est plus bas que la nef et ses bas côtés. Il a été bâti sur un noyau du XVIe siècle et remanié au XVIIe siècle. La rosace, quant à elle a été ajoutée au XIXe siècle. Quant au transept saillant, qui flanque le chœur, il remonte aux XVIe et XVIIe siècle. Petite particularité mais qui fait aussi le charme de ce bâtiment religieux: l’église est surmontée d’un clocheton ardoisé avec flèche à huit pans.
On accède à cette petite église entourée de son cimetière emmuraillé, où se dressent plusieurs belles croix en fonte, par une rampe d’accès située sur la droite. Bien qu’érigée au XIIIe siècle pour ses parties les plus anciennes, l’église saint Brice fut d’abord une simple chapelle (peut être castrale) avant de devenir église paroissiale en 1497. La présence d’un édifice funéraire de la famille de Seraing semble en effet faire de cette église de village un lieu servant aussi de chapelle familiale aux seigneurs de Hollogne. Ce mausolée consacré à Godefroid de Seraing et sa femme, Isabelle de Ponty, fut érigé en 1687 en marbre noir et porte une épitaphe.
On retiendra aussi parmi le mobilier de l’église, des fonts baptismaux à têtes humaines du début du XVIe siècle qui ont une base romane ainsi que des confessionnaux de style renaissance daté de 1630.
Presbytère du XVIIIe siècle
Situé un petit peu en retrait, derrière l’église, ce beau bâtiment du XVIIIe siècle révèle l’aisance de son occupant, un curé de village officiant sous l’Ancien Régime. Cet officiant était choisi par le chapitre saint Jean de Liège, qui avait la collation de l’église, sans doute parmi ses chanoines.
Il s’agit d’un des plus beaux presbytères de la région. C’est un édifice construit en brique et calcaire, limité par des harpes d’angle. La façade de deux niveaux et de trois travées est percée par des grandes baies rectangulaires à encadrement calcaire.
Au XIXe siècle, la maison fut équipée d’une annexe à vocation agricole qui comportait des étables et une porcherie et était pourvue d’une gerbière.
4. Les fermes et les habitations d’Hollogne
A côté des deux pôles politiques et religieux que sont le château, l’église et leurs dépendances, le village est essentiellement composé des fermes et d’exploitations agricoles, reflets de sa vie économique. Ce patrimoine rural revêt différentes formes dépendant de l’importance et de la qualité de ses occupants. La société hesbignonne était inégalitaire. A côté des seigneurs laïcs du village, plusieurs institutions ecclésiastiques, possédaient autrefois des biens dans la localité depuis le Moyen Âge. Parmi elles, les abbayes du Val Saint Lambert et du Neufmoustier et les chapitres de Saint Lambert et de Saint Jean. La cathédrale de liège cultivait plus de 30 bonniers à Hollogne tandis que le chapitre de Saint Jean possédait une cour foncière dans le village pour gérer ses biens. A l’époque moderne, les religieux ne cultivaient plus eux-mêmes les terres dans le finage de Hollogne, mais ils louaient fermes, terres et troupeaux à des fermiers des environs qui bien souvent avaient mieux réussi que la plupart des autres villageois, qui pouvaient payer un fermage élevé et qui avaient adopté le mode de vie des élites.
Mais la plupart des habitants n’avaient bien souvent que quelques bonniers à cultiver et dépendaient pour s’assurer leur existence du bon vouloir des possédants. Ainsi, les quelques grosse fermes du village, reprenant le plan en quadrilatère autour d’une cour, devancée d’un porche-colombier, équipée d’un beau logis et regroupant une grange souvent monumentale ainsi que une ou deux ailes d’écuries et d’étables suivant le cheptel du propriétaire, ne doivent pas faire oublier la multitude des petites maisons inconfortables construites en torchis et en pan de bois. Ces petites mansardes à toit de chaume, n’abritant bien souvent que deux petites pièces, étaient pourtant le lot de la majorité des villageois au Moyen Âge et à l’Epoque Moderne.
Hollogne-sur-Geer a également conservé quelques vestiges de cet habitat. Mais comme dans les autres villages de Hesbaye, ce sont les plus majestueuse fermes en quadrilatère qui attirent le regard. Ces grosses fermes hesbignonnes constituaient en quelque sorte autrefois les entreprises du village. Elles étaient pourvoyeuses d’emplois et engageaient vachers, servantes, « varlets », parfois même un herdier et un maréchal ferrant... De plus, pendant la bonne saison, leurs activités redoublaient et elles donnaient bien souvent aux villageois l’occasion de compléter leurs maigres revenus par un travail supplémentaire en fin de journée.
Ferme, rue du Centre
 L’histoire de cette ferme reste malheureusement à faire. Seules, son architecture et son environnement, nous permettent de dire que cette ferme a du appartenir à un des gros propriétaires du village. Ce vaste quadrilatère, en ordre serré se distingue par la présence d’une tour colombier quadrangulaire qui domine la ferme. Beaucoup de colombiers en Hesbaye sont associés au portail d’entrée qui est ici réduit à un modeste porche. L’ensemble de la ferme détonne dans le paysage par sa monumentalité et son implantation à l’intérieur du village. La vaste grange en double large construite en deux temps concourt à renforcer cette impression. D’autres bâtiments consacrés à l’élevage, écuries, étables, bergeries complètent les ailes du quadrilatère. Une bergerie est datée de 1789 en briques noires au pignon. Dans la cour, la fumière est décentrée et permet une meilleure circulation des chariots au sein même de l’entreprise agricole. Le logis est incomplètement millésimé de 17...9. Il a l’allure de maisons bourgeoises qu’on peut retrouver dans les bonnes villes de la Principauté à cette époque. Il s’agit d’une habitation à double corps asymétriques. Dans les pièces, plusieurs cheminées d’origine sont encore conservées. Des greniers et des petites chambres se partagent l’étage. L’irrégularité du plan du logis provient sûrement de la présence de la tour-colombier qui a obligé à réorganisé le nouveau logis autour du noyau de l’ancien. L’histoire de cette ferme reste malheureusement à faire. Seules, son architecture et son environnement, nous permettent de dire que cette ferme a du appartenir à un des gros propriétaires du village. Ce vaste quadrilatère, en ordre serré se distingue par la présence d’une tour colombier quadrangulaire qui domine la ferme. Beaucoup de colombiers en Hesbaye sont associés au portail d’entrée qui est ici réduit à un modeste porche. L’ensemble de la ferme détonne dans le paysage par sa monumentalité et son implantation à l’intérieur du village. La vaste grange en double large construite en deux temps concourt à renforcer cette impression. D’autres bâtiments consacrés à l’élevage, écuries, étables, bergeries complètent les ailes du quadrilatère. Une bergerie est datée de 1789 en briques noires au pignon. Dans la cour, la fumière est décentrée et permet une meilleure circulation des chariots au sein même de l’entreprise agricole. Le logis est incomplètement millésimé de 17...9. Il a l’allure de maisons bourgeoises qu’on peut retrouver dans les bonnes villes de la Principauté à cette époque. Il s’agit d’une habitation à double corps asymétriques. Dans les pièces, plusieurs cheminées d’origine sont encore conservées. Des greniers et des petites chambres se partagent l’étage. L’irrégularité du plan du logis provient sûrement de la présence de la tour-colombier qui a obligé à réorganisé le nouveau logis autour du noyau de l’ancien.
Ferme, rue d’Omal
Située un peu à l’extérieur du village, cette ferme a sans doute été édifiée au XIXe siècle pour la famille Delahaut. Elle ne figure pas sur le plan qu’on présente ici mais bien sur un autre plan daté de 1828 qui appartenait aussi à l’actuel propriétaire de la ferme. La dalle conservée dans le portail d’entrée, datée de 1737 et ornée des armes du seigneur, provient donc d’un autre endroit, la grange de la ferme du château. L’exploitation adopte cependant le plan traditionnel en carré des fermes de l’Ancien Régime. Elle rassemble aussi autour d’une cour pavée des bâtiments en briques couverts pour la plupart de tuiles et assure les mêmes fonctions, en accueillant logis et communs, sellerie et écuries de chevaux de selle, étables, poulailler, grange porcheries, écuries des chevaux de trait, remises de voiture ...
Le logis à double corps de deux niveaux et demi et 5 travées confirme le goût bourgeois pour la manière d’habiter des fermiers de la région. De grandes baies, éclairent l’intérieur. Cette imposante maison donne à l’arrière sur un parc. Manière de vivre et d’exploiter changent donc très peu dans la Hesbaye d’après la Révolution.
 |
Hollogne-sur-Geer, rue d'Omal, 1, schéma du plan terrier, état actuel
1. Logis et communs
2. Selleries et écuries des chevaux de selle
3. Etables
4. Poulailler
5. Grange
6. Porcheries
7. Ecuries des chevaux de trait
8. Bureau
9. Bascule
10. Etables récentes
11. Porche d'entrée
12. Puits
13. Remise à voitures |
Grange en colombage
 Sur la manière de construire autrefois, le village conserve quelques vestiges d’architecture en pan de bois dont une intéressante grange en colombage qui nécessite restauration. A l’abandon au milieu d’une prairie, cette grange est pourtant un des derniers témoignages architecturaux complets d’une manière de construire qui fut autrefois la plus répandue en Hesbaye. Cette grange date de 1683. Le millésime gravé d’une part sur deux piliers principaux intérieurs et d’autre part sur un pan de bois extérieur, l’atteste. Elle est hourdée de briques et sa structure présente un quadrillage serré de pans de bois. Dans les périodes plus anciennes, au Moyen Âge et au début de l’Epoque moderne, la structure en bois était destinée, non à accueillir des briques mais un hourdis composé de torchis. L’ossature en bois était alors complétée par un assemblage de bout de bois qui constituaient le clayonnage. De part et d’autre de cet assemblage (claie) était plaqué le torchis, principalement composé d’argile mélangé à de la paille et enduite d’eau et de chaux. Sur la manière de construire autrefois, le village conserve quelques vestiges d’architecture en pan de bois dont une intéressante grange en colombage qui nécessite restauration. A l’abandon au milieu d’une prairie, cette grange est pourtant un des derniers témoignages architecturaux complets d’une manière de construire qui fut autrefois la plus répandue en Hesbaye. Cette grange date de 1683. Le millésime gravé d’une part sur deux piliers principaux intérieurs et d’autre part sur un pan de bois extérieur, l’atteste. Elle est hourdée de briques et sa structure présente un quadrillage serré de pans de bois. Dans les périodes plus anciennes, au Moyen Âge et au début de l’Epoque moderne, la structure en bois était destinée, non à accueillir des briques mais un hourdis composé de torchis. L’ossature en bois était alors complétée par un assemblage de bout de bois qui constituaient le clayonnage. De part et d’autre de cet assemblage (claie) était plaqué le torchis, principalement composé d’argile mélangé à de la paille et enduite d’eau et de chaux.
Vestige de l’habitat rural du XVIIIe siècle
Dans la rue du centre, au n° 15, une petite construction datée du XVIIIe siècle retient l’attention. Il s’agit d’une habitation, sans doute propriété d’un manouvrier, en briques et calcaire peintes. Elle est accompagnée de deux porcheries.
Un peu plus loin, dans la même rue, au n° 33, on trouve une maisonnette de la fin du XVIIIe siècle en briques blanchies et colombage. Sa façade a été percée d’une porte rectangulaire et d’une fenêtre à encadrement de bois. Un des pignons ainsi que l’arrière ont conservé intact leur colombage. De nombreuses marques d’assemblage apparaissent encore.
Ces deux petites maisons sont des précieux vestiges et des témoignages de la manière d’habiter de la plupart des villageois qui se sont succédés à Hollogne-sur-Geer. Ce sont des petites habitations occupant peu de place et laissant deviner la proximité dans la quelle pouvaient vivre les familles villageoises d’autrefois. Cette situation ne s’améliorera qu’à la fin du XIXe siècle lorsque, fabriquée en quantité industrielle, la brique se diffusera dans toutes les couches de la population.
|
|
|


 Sur la manière de construire autrefois, le village conserve quelques vestiges d’architecture en pan de bois dont une intéressante grange en colombage qui nécessite restauration. A l’abandon au milieu d’une prairie, cette grange est pourtant un des derniers témoignages architecturaux complets d’une manière de construire qui fut autrefois la plus répandue en Hesbaye. Cette grange date de 1683. Le millésime gravé d’une part sur deux piliers principaux intérieurs et d’autre part sur un pan de bois extérieur, l’atteste. Elle est hourdée de briques et sa structure présente un quadrillage serré de pans de bois. Dans les périodes plus anciennes, au Moyen Âge et au début de l’Epoque moderne, la structure en bois était destinée, non à accueillir des briques mais un hourdis composé de torchis. L’ossature en bois était alors complétée par un assemblage de bout de bois qui constituaient le clayonnage. De part et d’autre de cet assemblage (claie) était plaqué le torchis, principalement composé d’argile mélangé à de la paille et enduite d’eau et de chaux.
Sur la manière de construire autrefois, le village conserve quelques vestiges d’architecture en pan de bois dont une intéressante grange en colombage qui nécessite restauration. A l’abandon au milieu d’une prairie, cette grange est pourtant un des derniers témoignages architecturaux complets d’une manière de construire qui fut autrefois la plus répandue en Hesbaye. Cette grange date de 1683. Le millésime gravé d’une part sur deux piliers principaux intérieurs et d’autre part sur un pan de bois extérieur, l’atteste. Elle est hourdée de briques et sa structure présente un quadrillage serré de pans de bois. Dans les périodes plus anciennes, au Moyen Âge et au début de l’Epoque moderne, la structure en bois était destinée, non à accueillir des briques mais un hourdis composé de torchis. L’ossature en bois était alors complétée par un assemblage de bout de bois qui constituaient le clayonnage. De part et d’autre de cet assemblage (claie) était plaqué le torchis, principalement composé d’argile mélangé à de la paille et enduite d’eau et de chaux.
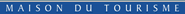

 La seigneurie et le village d’Hollogne furent le théâtre de nombreux conflits depuis le Moyen Âge. Déjà, lors de la guerre des Awans et des Waroux, ces derniers attaquèrent le château en 1312 et firent trancher la gorge à trois proches du seigneur, Jean de Harduémont, parce qu’il était proche du parti opposé des Awans.
La seigneurie et le village d’Hollogne furent le théâtre de nombreux conflits depuis le Moyen Âge. Déjà, lors de la guerre des Awans et des Waroux, ces derniers attaquèrent le château en 1312 et firent trancher la gorge à trois proches du seigneur, Jean de Harduémont, parce qu’il était proche du parti opposé des Awans.
 Situé un peu en retrait de la rue principale, l’ensemble du moulin seigneurial et de ses dépendances a été construit par le seigneur de Hollogne, Godefroid de Seraing, en 1646 sur le cours du Geer. Au Moyen Âge étaient souvent attachés au moulin des droits banaux qui permettaient au seigneur de contraindre les habitants de sa juridiction à venir moudre leur grain contre une redevance. Cette banalité était souvent une source précieuse de revenus pour le seigneur. Au XVIIIe siècle, un meunier était chargé du bon fonctionnement du moulin seigneurial. Le moulin rapportait 6 ½ setiers par semaine (un setier = 156 litres).
Situé un peu en retrait de la rue principale, l’ensemble du moulin seigneurial et de ses dépendances a été construit par le seigneur de Hollogne, Godefroid de Seraing, en 1646 sur le cours du Geer. Au Moyen Âge étaient souvent attachés au moulin des droits banaux qui permettaient au seigneur de contraindre les habitants de sa juridiction à venir moudre leur grain contre une redevance. Cette banalité était souvent une source précieuse de revenus pour le seigneur. Au XVIIIe siècle, un meunier était chargé du bon fonctionnement du moulin seigneurial. Le moulin rapportait 6 ½ setiers par semaine (un setier = 156 litres). Aujourd’hui son nouveau propriétaire, l’architecte Pierre Lorenzi, lui a assigné une nouvelle affectation. D’abord, les bâtiments ont été restaurés en 2006 et 2007. Ensuite, c’est tout naturellement vers la production d’électricité verte que la réhabilitation de la roue a été envisagée. Actuellement, la production d’électricité verte n’atteint que 25% de sa capacité. L’objectif est d’atteindre les 4 kW de puissance, ce qui permettra d’économiser près de 4,5 tonnes de CO², soit l’équivalent de 1% de la consommation de ménages moyens de la commune de Geer. La réaffectation du moulin s’oriente aussi vers la location des lieux en centre de séminaires, de festivités diverses ou encore d’ateliers du bien-être, afin qu’un large public puisse en bénéficier. S’exprime ainsi une volonté de diffuser la richesse patrimoniale et architecturale dans un esprit de « réaffectation respectueuse ». Ces fonctions permettent de maintenir les bâtiments dans leurs volumétries premières, sans cloisonnements intérieurs ni percements divers. Quant au corps de logis, il a conservé sa fonction résidentielle pour les propriétaires et leur famille. Un bel exemple d’un bâtiment ancien répondant aux défis d’aujourd’hui !
Aujourd’hui son nouveau propriétaire, l’architecte Pierre Lorenzi, lui a assigné une nouvelle affectation. D’abord, les bâtiments ont été restaurés en 2006 et 2007. Ensuite, c’est tout naturellement vers la production d’électricité verte que la réhabilitation de la roue a été envisagée. Actuellement, la production d’électricité verte n’atteint que 25% de sa capacité. L’objectif est d’atteindre les 4 kW de puissance, ce qui permettra d’économiser près de 4,5 tonnes de CO², soit l’équivalent de 1% de la consommation de ménages moyens de la commune de Geer. La réaffectation du moulin s’oriente aussi vers la location des lieux en centre de séminaires, de festivités diverses ou encore d’ateliers du bien-être, afin qu’un large public puisse en bénéficier. S’exprime ainsi une volonté de diffuser la richesse patrimoniale et architecturale dans un esprit de « réaffectation respectueuse ». Ces fonctions permettent de maintenir les bâtiments dans leurs volumétries premières, sans cloisonnements intérieurs ni percements divers. Quant au corps de logis, il a conservé sa fonction résidentielle pour les propriétaires et leur famille. Un bel exemple d’un bâtiment ancien répondant aux défis d’aujourd’hui ! Située un peu à l’écart du complexe castral, l’église Saint Brice, est un édifice au plan assez complexe. Les matériaux employés, brique, calcaire et grés régional, sont assez divers et révèlent un édifice construit sur plusieurs époques au gré de la fréquentation des paroissiens. Elle fut remaniée plusieurs fois et le bâtiment est composé d’une nef médiévale, de bas côtés, d’un transept et d’un chœur. Un portail latéral, daté de 1526 et placé au nord ouest de l’édifice, est englobé dans un porche du XVIIIe siècle. Une sacristie fut également ajoutée à cette époque.
Située un peu à l’écart du complexe castral, l’église Saint Brice, est un édifice au plan assez complexe. Les matériaux employés, brique, calcaire et grés régional, sont assez divers et révèlent un édifice construit sur plusieurs époques au gré de la fréquentation des paroissiens. Elle fut remaniée plusieurs fois et le bâtiment est composé d’une nef médiévale, de bas côtés, d’un transept et d’un chœur. Un portail latéral, daté de 1526 et placé au nord ouest de l’édifice, est englobé dans un porche du XVIIIe siècle. Une sacristie fut également ajoutée à cette époque. L’histoire de cette ferme reste malheureusement à faire. Seules, son architecture et son environnement, nous permettent de dire que cette ferme a du appartenir à un des gros propriétaires du village. Ce vaste quadrilatère, en ordre serré se distingue par la présence d’une tour colombier quadrangulaire qui domine la ferme. Beaucoup de colombiers en Hesbaye sont associés au portail d’entrée qui est ici réduit à un modeste porche. L’ensemble de la ferme détonne dans le paysage par sa monumentalité et son implantation à l’intérieur du village. La vaste grange en double large construite en deux temps concourt à renforcer cette impression. D’autres bâtiments consacrés à l’élevage, écuries, étables, bergeries complètent les ailes du quadrilatère. Une bergerie est datée de 1789 en briques noires au pignon. Dans la cour, la fumière est décentrée et permet une meilleure circulation des chariots au sein même de l’entreprise agricole. Le logis est incomplètement millésimé de 17...9. Il a l’allure de maisons bourgeoises qu’on peut retrouver dans les bonnes villes de la Principauté à cette époque. Il s’agit d’une habitation à double corps asymétriques. Dans les pièces, plusieurs cheminées d’origine sont encore conservées. Des greniers et des petites chambres se partagent l’étage. L’irrégularité du plan du logis provient sûrement de la présence de la tour-colombier qui a obligé à réorganisé le nouveau logis autour du noyau de l’ancien.
L’histoire de cette ferme reste malheureusement à faire. Seules, son architecture et son environnement, nous permettent de dire que cette ferme a du appartenir à un des gros propriétaires du village. Ce vaste quadrilatère, en ordre serré se distingue par la présence d’une tour colombier quadrangulaire qui domine la ferme. Beaucoup de colombiers en Hesbaye sont associés au portail d’entrée qui est ici réduit à un modeste porche. L’ensemble de la ferme détonne dans le paysage par sa monumentalité et son implantation à l’intérieur du village. La vaste grange en double large construite en deux temps concourt à renforcer cette impression. D’autres bâtiments consacrés à l’élevage, écuries, étables, bergeries complètent les ailes du quadrilatère. Une bergerie est datée de 1789 en briques noires au pignon. Dans la cour, la fumière est décentrée et permet une meilleure circulation des chariots au sein même de l’entreprise agricole. Le logis est incomplètement millésimé de 17...9. Il a l’allure de maisons bourgeoises qu’on peut retrouver dans les bonnes villes de la Principauté à cette époque. Il s’agit d’une habitation à double corps asymétriques. Dans les pièces, plusieurs cheminées d’origine sont encore conservées. Des greniers et des petites chambres se partagent l’étage. L’irrégularité du plan du logis provient sûrement de la présence de la tour-colombier qui a obligé à réorganisé le nouveau logis autour du noyau de l’ancien.
