
|
|
|
 C'est en 1195, dans les annales de l'abbaye de Saint Jacques à Liège, qu'il est fait mention pour la première fois de l'exploitation de la "terra nigra", la terre noire - c'est à dire de la houille -, en Hesbaye. Entre la fin du Moyen Âge et le début de l'Ancien Régime, des documents signalent des fosses entre la campagne de l'abbaye de la Paix-Dieu et le sart Polet à Antheit. Les ordres religieux et notamment les abbayes de Flône et de la Paix-Dieu furent les premières à exploiter la couche carbonifère qui affleurait à plusieurs endroits dans la région. A Villers-le-Bouillet, en 1606, on trouve la présence d'une houillère appartenant à la Paix-Dieu, à Halbosart. Cette dernière abbaye rétribuait des ouvriers pour le travail effectué pour la communauté monastique. C'est en 1195, dans les annales de l'abbaye de Saint Jacques à Liège, qu'il est fait mention pour la première fois de l'exploitation de la "terra nigra", la terre noire - c'est à dire de la houille -, en Hesbaye. Entre la fin du Moyen Âge et le début de l'Ancien Régime, des documents signalent des fosses entre la campagne de l'abbaye de la Paix-Dieu et le sart Polet à Antheit. Les ordres religieux et notamment les abbayes de Flône et de la Paix-Dieu furent les premières à exploiter la couche carbonifère qui affleurait à plusieurs endroits dans la région. A Villers-le-Bouillet, en 1606, on trouve la présence d'une houillère appartenant à la Paix-Dieu, à Halbosart. Cette dernière abbaye rétribuait des ouvriers pour le travail effectué pour la communauté monastique.
Avant la révolution industrielle, l'exploitation se faisait à fleur de terre ou par des galeries peu profondes situées dans une prairie ou à flanc de coteau. Celle qui avait été creusée depuis 1650 dans un pré près du moulin Haidon (ancien moulin banal de Villers-le-Bouillet) fut abandonnée un certain temps parce qu'une roche empêchait qu'on poursuive son exploitation. En 1730, on fit sauter la roche et on entreprit d'aller plus loin.
Le problème de l'évacuation des eaux se posa assez rapidement et on le résolut en partie par des araines qui permirent leur écoulement.
Au XVIIIe siècle, beaucoup de villersois exploitèrent la précieuse matière. Le chapitre Saint Barthélemy, seigneur du village comprit assez vite qu'il y avait là une nouvelle source de profit et soumit à son autorité le droit de creuser des bures, dès 1741. Le Val Notre Dame et l'abbaye de Neufmoutier s'ajoutèrent aux différents propriétaires qui reçurent des demandes d'exploiter leur terre. En général, les grands propriétaires ecclésiastiques soumirent à leur approbation, soit des redevances assez lourdes, soit des contrats ou étaient stipulés de manière très précise le partage des bénéfices entre l'exploitant et le propriétaire.
A la fin de l'ancien régime on trouvait des fosses et des petits terrils un peu partout dans la campagne de Villers non seulement aux Cabendes et à Halbosart mais aussi à la Marexhe à la Barbotte, derrière les courtils (jardins) et du côté du Fays.
Quelques vestiges de ces petits terrils, souvent boisés, sont encore visibles du côté de la Paix-Dieu, près de la route qui mène au Fays et la rue des petites haies, dans la campagne entre le Vieux clocher et la rue des Marronniers.
A la fin du XVIIIe siècle, Villers possédait près de 70 fosses. Sous le régime français beaucoup de procès permirent à certain de tirer profit de certaines situations et à faire définir leurs droits. On adjugea des concessions pour des durées beaucoup plus longues, d'environ cinquante ans, et l'administration française fit établir des plans de concessions qui délimitaient de façon plus précise où les exploitants pouvaient creuser. Cette modernisation mit fin à la situation anarchique qui prévalait avant la révolution française.
Au XIXe siècle, notamment après la vente comme biens nationaux des terres d'église, quatre grands charbonnages subsisteront : celui, d'Halbosart, celui de la Kiviétrie, l'ancien charbonnage de la Paix-Dieu et celui de Villers-le-Bouillet.
A cette époque, la machine à vapeur était présente dans les charbonnages villersois et comme on le sait, elle résolut un des problèmes majeures de l'exploitation en profondeur : l'exhaure des eaux. En 1846, le charbonnage de la Kiviétrie (ancienne propriété des chanoines de Neufmoutier) en possédait une qui ne pouvait être mise en mouvement que pendant la nuit car elle était trop proche du chemin. La fosse principale de ce charbonnage descendait jusqu'à 80 m de profondeur.
Vers 1840, le charbonnage dit de "Villers-le-Bouillet" exploitait une veine en spondréfosse.
A Halbosart, le puit mesurait 280 mètres de profondeur et à l'étage des 80 mètres se trouvait la galerie de Bende d'une longueur de 900 mètres. C'est par là qu'on utilisait des chevaux afin de transporter le charbon pour le laver et le trier suivant la grosseur.
Plusieurs fusions furent opérées au XIXe siècle. Ce fut d'abord celui de la Paix-Dieu dont la concession fut rattachée à celle de Halbosart vers 1840. En 1899, la Kiviétrie n'arrivait plus à investir dans des moyens d'extraction et se réunit avec le charbonnage de Halbosart. Toutes ces concessions furent reprises par une société anonyme des charbonnages de la Meuse en 1922 qui reprit également le charbonnage voisin du château du sart à Ampsin. Ces concessions cessèrent leur activité en 1930. Le puits de Bellevue avait en ce moment 300 m de profondeur. En 1954, les charbonnages de la Meuse repris l'exploitation sur une longueur de 1500 m à proximité de la Paix-Dieu, mais elle fut vite abandonnée.
Tous ces charbonnages n'eurent jamais le succès de ceux qui furent ouverts dans la proche banlieue de Liège. Ils furent beaucoup moins nombreux et le nombre d'ouvriers ne fut jamais très important. Pourtant la mine villersoise eut aussi ses catastrophes et ses martyrs. Déjà en 1689, un nommé Nicolas fut tué par suffocation en cherchant de la terroule. En 1849, quatre ouvriers furent asphyxiés et plus près de nous,  en 1928, 5 ouvriers furent noyés après qu'une poche d'eau fut percée et noya le puits. Dans les registres de décès qui se trouvent dans le presbytère et à l'administration communale, sont consignées une série de morts accidentelles. en 1928, 5 ouvriers furent noyés après qu'une poche d'eau fut percée et noya le puits. Dans les registres de décès qui se trouvent dans le presbytère et à l'administration communale, sont consignées une série de morts accidentelles.
Les charbonnages font partie de la mémoire de Villers et beaucoup se souviennent encore de la place que prenait le terril de Halbosart dans le paysage. Beaucoup de villersois se souviennent encore qu'on confectionnait des hochets pour se chauffer lorsqu'on mélangeait le charbon avec de la terre pour qu'il se consume plus lentement.
|
|
|



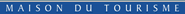
 C'est en 1195, dans les annales de l'abbaye de Saint Jacques à Liège, qu'il est fait mention pour la première fois de l'exploitation de la "terra nigra", la terre noire - c'est à dire de la houille -, en Hesbaye. Entre la fin du Moyen Âge et le début de l'Ancien Régime, des documents signalent des fosses entre la campagne de l'abbaye de la Paix-Dieu et le sart Polet à Antheit. Les ordres religieux et notamment les abbayes de Flône et de la Paix-Dieu furent les premières à exploiter la couche carbonifère qui affleurait à plusieurs endroits dans la région. A Villers-le-Bouillet, en 1606, on trouve la présence d'une houillère appartenant à la Paix-Dieu, à Halbosart. Cette dernière abbaye rétribuait des ouvriers pour le travail effectué pour la communauté monastique.
C'est en 1195, dans les annales de l'abbaye de Saint Jacques à Liège, qu'il est fait mention pour la première fois de l'exploitation de la "terra nigra", la terre noire - c'est à dire de la houille -, en Hesbaye. Entre la fin du Moyen Âge et le début de l'Ancien Régime, des documents signalent des fosses entre la campagne de l'abbaye de la Paix-Dieu et le sart Polet à Antheit. Les ordres religieux et notamment les abbayes de Flône et de la Paix-Dieu furent les premières à exploiter la couche carbonifère qui affleurait à plusieurs endroits dans la région. A Villers-le-Bouillet, en 1606, on trouve la présence d'une houillère appartenant à la Paix-Dieu, à Halbosart. Cette dernière abbaye rétribuait des ouvriers pour le travail effectué pour la communauté monastique.
 en 1928, 5 ouvriers furent noyés après qu'une poche d'eau fut percée et noya le puits. Dans les registres de décès qui se trouvent dans le presbytère et à l'administration communale, sont consignées une série de morts accidentelles.
en 1928, 5 ouvriers furent noyés après qu'une poche d'eau fut percée et noya le puits. Dans les registres de décès qui se trouvent dans le presbytère et à l'administration communale, sont consignées une série de morts accidentelles.