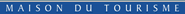|
Informations touristiquesExcursions groupesPromenadesVisites thématiquesMusées

Un tourisme de qualité dans un terroir accueillant
|
GénéralitésPatrimoine architecturalFermesPaysages

Un territoire, véritable photographie du patrimoine wallon
|

|
 Les paysages mêlent intimement l’action des hommes et de la nature. Ils sont souvent le résultat de plusieurs périodes historiques où se conjuguent actions passées et présentes. La Hesbaye a été marquée par les activités agricoles tandis que le paysage mosan a été bouleversé au XIXe siècle par la grande industrialisation de la vallée mosane et l’urbanisation qui s’en est suivie. Les paysages mêlent intimement l’action des hommes et de la nature. Ils sont souvent le résultat de plusieurs périodes historiques où se conjuguent actions passées et présentes. La Hesbaye a été marquée par les activités agricoles tandis que le paysage mosan a été bouleversé au XIXe siècle par la grande industrialisation de la vallée mosane et l’urbanisation qui s’en est suivie.La Hesbaye a également subi les changements contemporains même si elle a conservée une grande partie des structures paysagères héritées de plusieurs siècles. La prédominance sur son sol limoneux d’immenses étendues consacrées au labour sur un plateau à faible relief et presque dépourvu de ruisseaux et de bois, prévaut toujours aujourd’hui. Chaque village à l’habitat groupé autour de l’église est entouré d’un finage composé de champs ouverts traversé par une voirie utilitaire. Toutes ces terres ont toujours été cultivées et consacrées principalement aux céréales.  L’auréole villageoise a connue un grand développement des prairies vers 1950-1959. La plupart de ces prairies se trouvaient au creux de vallons où s’accumulait un peu d’humidité. Aujourd’hui les prés ont été remis en culture. L’auréole villageoise se compose de 2 couronnes concentriques. Celle qui enserrait les maisons et qui étaient composée de prés-vergers avec des arbres fruitiers à haute tige et l’autre plus récente, composée de prairies. Les vergers sont aujourd’hui en grande partie disparus face à la concurrence des fruits des pays du marché commun. Les grandes étendues labourées étaient souvent clairsemées de quelques massifs boisés localisés sur les plus mauvais sols et qui servaient de réserves de chasse. Les bords méridionaux de la Hesbaye et les abords de la Mehaigne et de ses affluents conservent encore de grandes étendues boisées. Il semble que les défrichements ont eu lieu très tôt sur le plateau. Des documents médiévaux et des toponymes conservent le souvenir de forêts du côté de Saives et vers le Geer, mais à la fin du Moyen Âge, les grandes étendues forestières ne sont plus qu’un souvenir. Des lignes de peupliers soulignent les vallées et les saules se retrouvent dans des prairies aux abords d’une mare ou d’un cours d’eau. Les parcs des châteaux enfin apportent aussi une touche non négligeable au paysage en alternant étendues boisées et prairies.  La carte du comte de Ferraris dressée par les arpenteurs et les géomètres de l’armée autrichienne au début du XVIIIe siècle montre bien la localisation et la forme des complexes villageois composés de maisons auxquels étaient associés des vergers. L’openfield – grandes campagnes dont la clôture est totalement absente – domine le paysage. Ces champs remontent aux habitudes collectives issues des pratiques agraires du Moyen Âge : l’assolement triennal et son complément la vaine pâture. Ce type d’assolement est d’ailleurs attesté au XIIIe siècle à Seraing-le-Château dans les terres exploitées par les convers de l’abbaye du Neufmoutier. La carte du comte de Ferraris dressée par les arpenteurs et les géomètres de l’armée autrichienne au début du XVIIIe siècle montre bien la localisation et la forme des complexes villageois composés de maisons auxquels étaient associés des vergers. L’openfield – grandes campagnes dont la clôture est totalement absente – domine le paysage. Ces champs remontent aux habitudes collectives issues des pratiques agraires du Moyen Âge : l’assolement triennal et son complément la vaine pâture. Ce type d’assolement est d’ailleurs attesté au XIIIe siècle à Seraing-le-Château dans les terres exploitées par les convers de l’abbaye du Neufmoutier.Aux abords de la Meuse, les zones boisées présentes sur la carte étaient beaucoup plus importantes. Au XIXe siècle, d’importants défrichements ont encore eu lieu, donnant naissance à de nouveaux terroirs exploités par des nouvelles fermes comme au bois de Saint Lambert à Amay ou à Jehay aux environs de la ferme du « bois royal ». On remarque aussi de longues drèves arborées dont certaines subsistent encore aux alentours des châteaux ou le long de certaines chaussées. L’ancienne chaussée romaine Amay-Tongres est par contre dépourvue de tout arbre et traverse les campagnes en évitant les villages. L’extraction du phosphate dans le sous-sol crayeux ainsi que quelques houillères, des briqueteries et des tuileries ont marqué de façon très locale le paysage. L’extraction de la pierre et les fours à chaux se cantonnent dans la région mosane, là où la révolution industrielle marquera le plus ses effets. Les structures agraires de Hesbaye subirent des changements à partir du XIXe siècle. L’ancien assolement encore présent au début de ce siècle fut abandonné. Le système qui consistait à laisser une partie du terroir en jachère  disparut complètement. Les nouveaux systèmes de production agricole consacrèrent toujours la large part aux céréales - certaines surfaces consacrées aux céréales atteignaient les 90% de la superficie de certains villages - mais aussi à la betterave sucrière, aux pommes de terre, à la culture maraîchère ainsi qu’aux plantes industrielles. Sous l’Ancien Régime on cultivait surtout de l’épeautre, mais le froment finit par dominer. disparut complètement. Les nouveaux systèmes de production agricole consacrèrent toujours la large part aux céréales - certaines surfaces consacrées aux céréales atteignaient les 90% de la superficie de certains villages - mais aussi à la betterave sucrière, aux pommes de terre, à la culture maraîchère ainsi qu’aux plantes industrielles. Sous l’Ancien Régime on cultivait surtout de l’épeautre, mais le froment finit par dominer.Partout en Hesbaye, c’est la grosse exploitation qui l’emporta. Au début du XIXe siècle, le mouvement n’était pas encore donné. Beaucoup de petites exploitations avec quelques porcs et des superficies de moins d’un hectare subsistaient dans les villages proches de la vallée mosane (Villers, Warnant, Jehay, ...). Elles appartenaient à des ouvriers qui voyaient là un moyen de subsistance complémentaire. De plus avant la mécanisation agricole, il se construisit encore des fermes en quadrilatère avec des granges et des étables, dont le mode de construction était calqué sur les modèles anciens. Mais au XXe siècle, la situation se transforma radicalement. Le cheval de labour fut remplacé par le tracteur. Progressivement, la petite exploitation a disparue et les moyennes devinrent de moins en moins nombreuses. Les nouvelles contraintes de l’agriculture eurent des effets sur le changement dans les grosses censes. Les récoltes partirent directement vers les silos et les betteraves furent directement acheminées vers les sucreries. Les vastes granges devinrent donc inutiles et furent parfois transformées en étables d’engraissement car les anciennes étables et les écuries désertées des chevaux de labours étaient insuffisantes pour les grands troupeaux. Dans beaucoup de cas on a eu recours à la construction de nouveaux bâtiments alors que des parties anciennes de la ferme étaient inutilisées. Malgré toutes ces modifications, les villages de plateaux se caractérisent toujours par la prédominance de la culture et son complément en betteraves sucrières.  Le rebord mosan se différencie aussi du plateau de Hesbaye par des sols plus pauvres, des zones boisées plus étendues et un paysage différent dû aussi au relief. La vallée mosane a connu une économie très différente et cela dès l’Ancien Régime avec une exploitation de la forêt liée à la pré-industrialisation. La vigne aussi, apparue dès le Haut Moyen Âge, fit partie du paysage agraire sur les coteaux de la rive gauche du fleuve jusqu’à la seconde guerre mondiale. En 1846, les vignobles d’Amay (9,58 ha) et d’Ampsin (5,46 ha) occupaient pour la superficie exploitée les troisièmes et quatrièmes places derrière Huy et Liège. Le rebord mosan se différencie aussi du plateau de Hesbaye par des sols plus pauvres, des zones boisées plus étendues et un paysage différent dû aussi au relief. La vallée mosane a connu une économie très différente et cela dès l’Ancien Régime avec une exploitation de la forêt liée à la pré-industrialisation. La vigne aussi, apparue dès le Haut Moyen Âge, fit partie du paysage agraire sur les coteaux de la rive gauche du fleuve jusqu’à la seconde guerre mondiale. En 1846, les vignobles d’Amay (9,58 ha) et d’Ampsin (5,46 ha) occupaient pour la superficie exploitée les troisièmes et quatrièmes places derrière Huy et Liège.Quant à l’industrie, elle marqua surtout la vallée de la Meuse à Flône et celle de Bende où plusieurs industries extractives s’installèrent. A Villers, au Sart d’Ampsin, à Bodegnée et à Jehay, plusieurs charbonnages se développèrent. Quelques terrils, parfois aux dimensions très petites, témoignent encore de cette activité aujourd’hui révolue. Sur le versant rive droite de la Meuse, commence l’Ardenne condrusienne que l’on confond souvent avec le Condroz. Des villages comme Ombret vécurent aussi de l’exploitation de la forêt. Au-dessus du village, au lieu-dit, « les communes » on y exploitait la forêt et les taillis en cycles réguliers d’essartage ; de fabrications de charbon de bois et cultures sur brûlis, de pâturage et de plantation d’arbrisseaux. La lande herbeuse qu’on voit à cet endroit est le résultat des bouleversements de l’écosystème. |
Bibliographie | Publications | Vie privée | Presse | Liens | Partenaires | Galerie Photo | Crédits | Annuaire | RSS