Région géographique : Le rebord mosan
Panneaux didactiques Départ : devant le château de Warfusée
Kilométrage : 7km400
Balisage : flèche avec mention circuit du Renard
Aires de repos. Bancs et poubelles
Dénomination locale : Circuit du Renard
Téléchargez la carte du circuit
1. Château de Warfusée. Le château et le domaine de Warfusée marquent profondément le paysage de la

commune de Saint-Georges. Le parc, les terres et les bois s’étendent sur plusieurs centaines d’hectare. Il est l’héritier d’un immense domaine médiéval. Le château actuel date cependant de 1755. Il est l’actuelle propriété de la famille d’Oultremont de Wégimont de Warfusée. L’un des plus illustre représentant de cette famille originaire de Warnant fut le prince-évêque Charles-Nicolas d’Oultremont (1716-1771) qui se servit de ce château comme résidence d’été.
Après avoir pris un chemin entre deux rangées de hêtres séculaires, on entre dans le château par une tour porche reconstruite en 1720. La cour d’honneur du château accueille quelques dépendances en pierres grises. La résidence proprement dite est de style Louis XV et a été reconstruite sous la direction de l’architecte de Hermalle, Jean Gilles Jacob. Elle accueille quelques belles pièces comme la chambre du prince-évêque, des salons et un boudoir, tous décorés avec goût.
Le château est néanmoins une demeure privée qui ne se visite exclusivement que par groupes à certaines occasions.
 2. La ferme du château.
2. La ferme du château. Chaque demeure seigneuriale est généralement accompagnée d’une ferme qui en assure l’intendance. Le quadrilatère de la ferme du château a été reconstruit en 1766. Un portail en anse de panier sert d’entrée. De part et d’autre de ce porche, deux bâtiments très symétriques abritaient d’une part le maître et sa famille et d’autre part les ouvriers saisonniers. La ferme fut construite avec des briques fabriquées sur place. L’extraction de l’argile donna lieu à un creux qui en se remplissant d’eau donna naissance à un étang (comblé aux environs de 1950).
La famille d’Oultremont exploitait également du charbon. On n’est pas très loin du sillon industriel de la Meuse. Un puits d’extraction se trouvait près de la route d’Engis, un autre derrière la ferme du château.
3. L’école du Préau construite en 1830 est actuellement reconvertie en résidence. Elle fut à ses débuts tenue par des religieuses. L’école ferma ses portes en 1956 et ses classes furent transférées à l’Ecole Moyenne aujourd’hui Athénée Royal. En 1833 elle est tenue par les Sœur de Saint Vincent jusqu’en 1852. En 1878 elle est tenue par Les Dames de la Sainte Union. Elle devient une école communale en 1875.
4. Le presbytère faisait également partie du domaine de Warfusée. C’est le comte qui payait le chapelain. Actuellement, c’est une jolie propriété au pignon en escalier crépi de blanc.
Au rond point, devant le château prendre la route direction Engis et longer la propriété de la ferme du château. Après le mur, entrer dans le bois des Gattes à droite, en prenant le sentier.
Le circuit traverse les bois du « Parc » et descend vers le ruisseau du Vieux Logis qui prend sa source à Stockay et se jette dans la Meuse à la Mallieue. Son cours inférieur est canalisé.
On traverse la route qui rejoint La Mallieue. On continue dans le bois jusqu'à l’aire de repos. On prend la rue des « Gorliers » dont le nom provient de « Gorli » qui signifie bourrelier et on atteint le quartier du Tige. On passe d evant l’ancienne chapelle Saint André qui fut érigée en 1956 mais qui n’est déjà plus un lieu de culte.
evant l’ancienne chapelle Saint André qui fut érigée en 1956 mais qui n’est déjà plus un lieu de culte.
On prend à gauche puis quelques mètres plus loin on emprunte un sentier asphalté à droite.
5. Le quartier du Tige. Le mot « tige » est déjà utilisé au Moyen Âge. Il désignait un chemin creux peu praticable bordé de talus herbeux. Au XIX
e siècle et au siècle dernier, la mentalité du quartier du Tige était très différente de celle du reste de la commune. C’était un quartier populaire et ouvrier, très peuplé. Cette population se répartissait dans un dédale de ruelles et travaillait dans les mines et les carrières locales. On les surnommait les « cwerbas » (corbeaux) peut-être à cause de leurs vêtements et de leurs visages noircis par la poussière du charbon. S’il est vrai que les gens vivaient pauvrement, leur solidarité était cependant légenda ire. On retrouve encore des traces de cet habitat ouvrier dans quelques petites maisons qui n’ont presque pas subies de transformations.
Quand on arrive devant une propriété on continue le chemin vers la gauche jusqu’à la rue de la Baume qu’on prend à gauche. On la quitte un peu plus loin à gauche puis à droite. On arrive alors à une aire de repos.
6. Rue de la Baume : une baume est une sorte de salle souterraine souvent formée dans une galerie d’extraction. Dans cette partie du village, de petites exploitations minières virent le jour mais furent éphémères car le charbon y était de mauvaise qualité.
Derrière la piste de pétanque, s’élève un terril boisé. Autrefois, il était surmonté d’un aérien qui y amenait les déchets carriers du siège de la société Dumont Wautier à la Mallieue.
Lors de la construction du chemin de fer dans la vallée de la Meuse, beaucoup d’habitants allèrent travailler dans les usines du bassin industriel de Liège. Ils empruntaient la rue de la Baume puis le chemin de la Boulade (remplacés aujourd’hui par un site d’extraction) pour se rendre à la gare de Hermalle. Un gisement du Mésolithique fut également découvert dans ce hameau. Les pièces recueillies sont actuellement visibles au musée archéologique communal de Saint-Georges.
On prend ensuite à droite le long des remblais des carrières Dumont Wautier. On arrive près d’un bois. Après avoir passé la barrière on emprunte le sentier à droite sous les frondaisons.
On contourne ensuite les terrains de football et les vestiaires pour rejoindre une route (Rue Joseph Wauters) qu’on prend à gauche. On arrive au carrefour dénommé « le Coin du Mur ».
7. Coin du Mur. Cet endroit était la limite de l’enceinte du parc du château. Ce mur datait de 1600 et passait dans la partie gauche du tige. On retrouve encore quelques éléments dans des murs et des fondations plus anciennes comme au 77 de la rue Joseph Wauters.
 8. Stockay.
8. Stockay. On traverse le centre de Stockay. Le mot germanique « stock » signifiait souche. Le hameau se présente actuellement comme assez dense. Au XIX
e et au début du XX
e siècle, il avait une physionomie plus rurale. Une campagne, la campagne Boxus, occupait l’actuelle place publique (Place Th. Douffet). Le centre du village était pratiquement inoccupé. Le « haut Stockay » était le cœur de la vie sociale et économique du village. C’était le quartier où se trouvaient l’église, l’école, les commerces et les cafés et où quelques industries (forge, moulin et brasserie) prospéraient.
Au rond point on prend la rue de la Bourse qu’on suit pendant quelques mètres puis on prend la petite route à droite qui descend vers les fonds.
9. La Bourse. Cette voirie avec celle du « Coin du Mur » était assez urbanisée et elle doit son aspect à la famille Lecrenier dont l’ancêtre Arnold était originaire des Awirs. Il vint s’installer dans cette rue et fit construire l’école du coin du mur en 1892. Son entreprise de construction prospéra grâce à l’appoint de ses 4 fils et de sa fille. Ils formaient une bonne équipe. Un des fils s’occupait des transports et du commerce du charbon. Deux d’entre eux furent menuisiers et le dernier architecte amateur et comptable préposé aux ventes et aux achats. Ils firent construire près de 650 maisons dont 125 à leur compte.
La rue de la Bourse doit son nom à une maison de style Renaissance mosane, où ce nom était gravé et daté de 1674. Il se peut qu’à cet endroit on payait un droit de passage entre les seigneuries d’Hermalle et de Warfusée.
Cette ruelle relie la rue de la Bourse à celle de Basse-Marquet
10. Un fonds humide. On passe à côté des sources du ruisseau de la Macrâle qui se jette dans le ruisseau de Flône, petit affluent de la Meuse. La rue Basse Marquet était jadis un endroit marécageux. Basse serait à prendre au sens du mot wallon flaque qui pouvait parfois vouloir dire mare. Marquet serait le nom d’un habitant de ce lieu.
Dès qu’on rejoint la route on la prend à gauche puis on prend le chemin de remembrement bétonné. A l’entrée sur la gauche, on aperçoit l’arrière de la ferme de la Sarte.
11. La ferme et la campagne de la Sarte. Elle daterait de la fin du XVIII
e siècle. Ses bâtiments joignaient jadis un moulin à farine. Le nom de « sarte » (et à l’essartage qui a suivi) qu’on attribue à la ferme et son terroir, fait évidemment allusion aux défrichements.
Après la traversée de cette campagne, au ¾ du chemin on prend le chemin de droite pour rejoindre le hameau de Yernawe qui tire son nom de la rivière Yerne, affluent du Geer, qui y prend sa source.
 12. La ferme de l’abbaye de Saint-Jacques.
12. La ferme de l’abbaye de Saint-Jacques. Yernawe était un ancien alleu indépendant de la seigneurie de Warfusée. Appartenant au domaine primitif du chapitre de Saint Lambert, il fut donné par l’évêque à l’abbaye bénédictine de Saint Jacques pour permettre sans doute à celle-ci de compléter son domaine nécessaire à la subsistance de ses moines. Les terres du village furent donc en grande partie cultivées à partir d’une grange puis d’une ferme. Le porche-colombier qui sert d’entrée à l’exploitation est surmonté d’une pierre calcaire, millésimée 1664 et frappée aux armes de Gilles de Geer, ancien abbé de Saint-Jacques. La ferme est un de ces vastes quadrilatères composés d’un corps de logis, d’étables, d’écuries et d’une grange monumentale. Une ancienne chapelle jadis dédiée à notre Dame et incorporée jadis à la ferme a malheureusement disparu. Contrairement aux cisterciens, les moines noirs prévoyaient dans leurs fermes un bâtiment pour assister aux offices.
13. Le tumulus et la chaussée romaine. Le hameau de Yernawe est aussi un lieu riche en vestiges historiques et archéologiques. La chaussée romaine Tongres-Arlon, le traversait. En bordure de celle-ci s’élève un imposant tumulus de 20m de hauteur et de 50m de diamètre. Il est surmonté d’une chapelle construite au XIX
e siècle et dédiée à Saint Donat qu’on priait pour se protéger de la foudre et à la Sainte Trinité qui protégeait des maux de tête.
Le tumulus et la ferme de l’abbaye de Saint Jacques sont légèrement en dehors du circuit. Si on veut se rendre au premier on suit la rue de Yernawe et à la chaussée verte on tourne à droite. Le tumulus est dans le virage à gauche dans un petit chemin. Si on veut voir la ferme abbatiale en rebroussant chemin vers le circuit on tourne à gauche par la rue du Château d’Eau.
 On reprend le circuit et on passe devant la ferme du Warihet.
14. Le Warihet.
On reprend le circuit et on passe devant la ferme du Warihet.
14. Le Warihet. La ferme du Warihet a un portail surmonté des armoiries de la famille Favereau et millésimé 1701. Le nom de Warihet nous renseigne sur le type de terrain qu’on traverse. Les waréchaix, wérixhas ou Warihet sont souvent des terrains vagues, des mauvaises terres, qu’on laisse à la communauté rurale pour la pâture du bétail.
Après la rue du Warihet, on contourne une propriété et on se retrouve dans la rue Bida qui fait partie du GR.579. On rejoint alors par le sentier la drève du château de Warfusée. 15. La drève.
15. La drève. On suit alors la drève qui, plantée de 214 platanes est une allée d’honneur menant au château de Warfusée.
C’était un lieu de promenade très apprécié au siècle dernier. L’allée était couverte de cailloux blancs et bordée de pelouses régulièrement fauchée. Un berceau planté de charmes et agrémenté de bancs y constituait un agréable lieu de repos. Une grille en fer forgé soutenue par des piliers en calcaire agrémentait cet endroit.
A la fin de l’allée, on peut voir les ruines de l’ancienne église de Stockay. Construite en 1834 par le comte Emile d’Oultremont, ambassadeur de Belgique à Rome, elle était dédiée à Saint Emile. Elle renfermait les reliques de Saint Julien et de Sainte Aurélie dont le pape fit présent à la famille d’Oultremont. Lors de la désaffection de l’église, on transféra ces reliques dans la chapelle du château.
On rejoint le château de Warfusée, point de départ et d’arrivée de notre parcours.




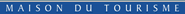
 commune de Saint-Georges. Le parc, les terres et les bois s’étendent sur plusieurs centaines d’hectare. Il est l’héritier d’un immense domaine médiéval. Le château actuel date cependant de 1755. Il est l’actuelle propriété de la famille d’Oultremont de Wégimont de Warfusée. L’un des plus illustre représentant de cette famille originaire de Warnant fut le prince-évêque Charles-Nicolas d’Oultremont (1716-1771) qui se servit de ce château comme résidence d’été.
commune de Saint-Georges. Le parc, les terres et les bois s’étendent sur plusieurs centaines d’hectare. Il est l’héritier d’un immense domaine médiéval. Le château actuel date cependant de 1755. Il est l’actuelle propriété de la famille d’Oultremont de Wégimont de Warfusée. L’un des plus illustre représentant de cette famille originaire de Warnant fut le prince-évêque Charles-Nicolas d’Oultremont (1716-1771) qui se servit de ce château comme résidence d’été. 2. La ferme du château. Chaque demeure seigneuriale est généralement accompagnée d’une ferme qui en assure l’intendance. Le quadrilatère de la ferme du château a été reconstruit en 1766. Un portail en anse de panier sert d’entrée. De part et d’autre de ce porche, deux bâtiments très symétriques abritaient d’une part le maître et sa famille et d’autre part les ouvriers saisonniers. La ferme fut construite avec des briques fabriquées sur place. L’extraction de l’argile donna lieu à un creux qui en se remplissant d’eau donna naissance à un étang (comblé aux environs de 1950).
2. La ferme du château. Chaque demeure seigneuriale est généralement accompagnée d’une ferme qui en assure l’intendance. Le quadrilatère de la ferme du château a été reconstruit en 1766. Un portail en anse de panier sert d’entrée. De part et d’autre de ce porche, deux bâtiments très symétriques abritaient d’une part le maître et sa famille et d’autre part les ouvriers saisonniers. La ferme fut construite avec des briques fabriquées sur place. L’extraction de l’argile donna lieu à un creux qui en se remplissant d’eau donna naissance à un étang (comblé aux environs de 1950). evant l’ancienne chapelle Saint André qui fut érigée en 1956 mais qui n’est déjà plus un lieu de culte.
evant l’ancienne chapelle Saint André qui fut érigée en 1956 mais qui n’est déjà plus un lieu de culte.
 12. La ferme de l’abbaye de Saint-Jacques. Yernawe était un ancien alleu indépendant de la seigneurie de Warfusée. Appartenant au domaine primitif du chapitre de Saint Lambert, il fut donné par l’évêque à l’abbaye bénédictine de Saint Jacques pour permettre sans doute à celle-ci de compléter son domaine nécessaire à la subsistance de ses moines. Les terres du village furent donc en grande partie cultivées à partir d’une grange puis d’une ferme. Le porche-colombier qui sert d’entrée à l’exploitation est surmonté d’une pierre calcaire, millésimée 1664 et frappée aux armes de Gilles de Geer, ancien abbé de Saint-Jacques. La ferme est un de ces vastes quadrilatères composés d’un corps de logis, d’étables, d’écuries et d’une grange monumentale. Une ancienne chapelle jadis dédiée à notre Dame et incorporée jadis à la ferme a malheureusement disparu. Contrairement aux cisterciens, les moines noirs prévoyaient dans leurs fermes un bâtiment pour assister aux offices.
12. La ferme de l’abbaye de Saint-Jacques. Yernawe était un ancien alleu indépendant de la seigneurie de Warfusée. Appartenant au domaine primitif du chapitre de Saint Lambert, il fut donné par l’évêque à l’abbaye bénédictine de Saint Jacques pour permettre sans doute à celle-ci de compléter son domaine nécessaire à la subsistance de ses moines. Les terres du village furent donc en grande partie cultivées à partir d’une grange puis d’une ferme. Le porche-colombier qui sert d’entrée à l’exploitation est surmonté d’une pierre calcaire, millésimée 1664 et frappée aux armes de Gilles de Geer, ancien abbé de Saint-Jacques. La ferme est un de ces vastes quadrilatères composés d’un corps de logis, d’étables, d’écuries et d’une grange monumentale. Une ancienne chapelle jadis dédiée à notre Dame et incorporée jadis à la ferme a malheureusement disparu. Contrairement aux cisterciens, les moines noirs prévoyaient dans leurs fermes un bâtiment pour assister aux offices. On reprend le circuit et on passe devant la ferme du Warihet.
On reprend le circuit et on passe devant la ferme du Warihet.